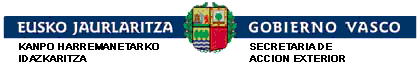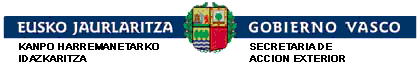|
 Les biographies de certaines personnes, nous rapportent quantité de faits historiques, en rapport avec le pays où ils ont vécu. L'un de ces personnages est Jean-Louis Harguindéguy. La vie de cet homme, originaire du Pays Basque, est liée à l'histoire des cinquante dernières années du Québec. Les biographies de certaines personnes, nous rapportent quantité de faits historiques, en rapport avec le pays où ils ont vécu. L'un de ces personnages est Jean-Louis Harguindéguy. La vie de cet homme, originaire du Pays Basque, est liée à l'histoire des cinquante dernières années du Québec.
Dans les années 1950 , le Québec a vécu : " la révolution tranquille ". Les événements qui se sont déroulés à cette époque font partie aussi de l'histoire de M. Harguindéguy.
Afin que le lecteur comprenne mieux le contexte du Québec entre 1960 et 1980, c'est à dire l'époque de " la Révolution tranquille ", nous allons vous présenter une définition. Ainsi, nous pouvons dire que, la notion de nationalité " Québécoise " s'est substituée à celle de " Canadienne-franÇaise ". En même temps, les francophones du Québec sont entrés dans l'ère du modernisme : nationalité, économie, réorganisation, réformes du Statut des Québécois. Tout ceci, grâce à la bonne volonté de tous.
L'expérience personnelle de Jean-Louis Harguindéguy nous introduit dans l'histoire du Québec des cinq dernières décennies. Nous serons surpris de savoir comment la vie d'un immigré originaire du Pays basque nous rapproche de la " révolution tranquille "par les fonctions qu'il a occupées et par son caractère.
L'arrivée d'un jeune basque au Québec !
Le 15 février 1952, accompagné de sa sœur Maité,
pour la première fois, Jean Louis Harguindéguy débarque
au Québec. Il avait alors fait un voyage de sept jours,
en bateau, avec la compagnie Cunard.

Il est né à Saint-Palais/Donapaleu en Basse-Navarre. Il
suivit des études au petit séminaire de Larresore
et au collège St-Louis-de-Gonzague à Bayonne. Ils débarquèrent
à Halifax, à l'est du Québec et de là prirent le
train pour Montréal. Ainsi ils firent un voyage
de quinze heures, dans un hiver glacial, pour voir leur père.
La famille avait pris la décision d'arriver au Québec,
en tant qu'immigrés. Ce furent les premiers contacts qu'il
eut avec l'Amérique du Nord, à l'âge de quinze ans.
Les premières pas dans le monde du travail
Son premier emploi fut aide-comptable au " Crédit Foncier franco-canadien " à Montréal. Puis, il décida de changer de travail, car il était en désaccord avec sa direction. En 1954, il demanda une augmentation hebdomadaire de 5 $ canadiens alors que son employeur lui imposait de prendre, à ses frais, les cours d'université pour obtenir le diplôme officiel de comptable. Aujourd'hui le rappel de ce souvenir lui paraît comme un entêtement de jeunesse.
Puis, il poursuivit son expérience professionnelle dans une quincaillerie de Montréal. Dans cette entreprise, tous les jeunes, pour leur premier emploi, étaient polyvalents.
En 1955, il entra dans l'Armée Canadienne, fit partie du " 22ème régiment Royal " situé dans le quartier Valcartier de la ville du Québec. Il alla en Allemagne, à Werl. A cette époque, être militaire était considéré comme être partisan de l'armée d'occupation. Il fit un voyage en Europe avec le même bateau qu'à l'aller : cette fois-ci les services à bord étaient de mauvaise qualité. Deux années plus tard, il revint au Québec, avec le même embarquement et il continua comme formateur des jeunes appelés. Il obtint rapidement un poste dans les services administratifs. Il commenÇa à travailler dans les services comptables. Entre temps, il épousa une jeune normande, qu'il connut lors de vacances prises en France. Ils retournèrent au Canada, et eurent trois enfants : Rose-Marie, Catherine et Pierre-Louis.
De l'armée au syndicat
En 1964, il eut des différends avec son employeur qui était l'armée. Il sortit major de l'école militaire de Kingston, où il fit une formation en langue anglaise exclusivement. Cette distinction ne fut pas reconnue par les militaires du Québec. Ainsi, il n'eut pas de poste équivalent à sa formation ni de salaire correspondant. Alors, il prit en charge de défendre son avenir. Selon sa théorie, à la faÇon d'un basque, digne, il saisit la justice : il frappa la porte au Ministère de la Défense et cette administration reconnut l'erreur administrative et lui donna raison.
Cette même année, au début du printemps, il répondit à une offre d'emploi : au sein du Gouvernement du Québec, inspecteur comptable. En août, il fut admis et prit le poste.
A cette époque, le gouvernement du Québec connut une grande campagne de syndicalisation. Le Premier Ministre d'alors avait déclaré : "La Reine ne négocie pas avec ses subordonnés". L'expérience de la vie fait dire à Jean-Louis Harguindéguy que cette phrase est toujours d'actualité.
Comme il était impliqué dans beaucoup d'associations, il saisit cette opportunité. Voilà, que le jour même de son embauche, il prit la carte du syndicat et prit la décision de faire partie de l'organisation syndicale. Vite après, au printemps 1965, il accepta, pour la première fois, la direction du syndicat des fonctionnaires du Québec. Il continua dans ce syndicat jusqu'en 1993. Les deux premières années, il était porte-parole du syndicat au ministère pour les problèmes liés à l'urbanisme. Jean Louis Harguindéguy était responsable des crédits à long terme accordés à l'ensemble des écoles du Québec. Avec Guy St-Cyr de la ville du Québec, il fit la promotion de l'équipe sportive locale de Soccer-Football. St-Cyr était d'origine Haïtienne et était fonctionnaire du Gouvernement du Québec. Tous les deux, ils prirent la direction des deux équipes (senior et junior). Ils firent des offres de formation aux arbitres et aux entraîneurs des jeunes de la région du Québec. Cette année-là, il prit la décision de terminer les études qu'il avait commencées à l'université de Laval en 1954.
Au printemps 1967, il fut élu vice-président du " Syndicat des Fonctionnaires Provinciaux du Québec (SFPQ) ". Ce syndicat rassemblait 40 000 adhérents. Tous les fonctionnaires publics du Québec : bureaux, services techniques etc... Les employés et les ouvriers étaient répartis dans 300 sections différentes : des pilotes d'avion du Gouvernement, aux cantonniers, en passant par les employés de bureaux...
De l'automne 1969 au printemps 1973, il fut secrétaire général du syndicat. Puis, à partir du 19 mai 1973, et pendant 20 ans, il fut élu président du syndicat SFPQ. Il a négocié, six fois, la convention collective des fonctionnaires du Gouvernement. Il utilisa plusieurs méthodes pour arriver à ses fins : grèves partielles ou générales.
Il devint pratiquement un personnage public. D'ailleurs, il eut beaucoup de relations avec les personnalités politiques les plus connus. Ainsi, il eut l'occasion de connaître le Premier Ministre du Québec : Daniel Johnson, père, et Pierre-Marc Johnson, le fils, Robert Bourassa, René Lévesque et Jacques Parizeau entre autres. Il faut rappeler que Robert Bourassa fit honneur à Harguindéguy quand il l'invita au repas lors de la visite officielle de FranÇois Miterrand : il fut le seul invité des représentants syndicaux. Lors de ses obligations professionnelles il eut l'occasion de connaître Jean-Roch Boivin, Lucien Bouchard et Bernard Landry avant qu'ils soient nommés Premier Ministre.
En qualité de Président du Syndicat, il avait la gestion de 15 millions de dollars canadiens, par an, pour assurer le fonctionnement de ses services. Au sein du syndicat, une centaine d'employés étaient salariés dans les différents services administratifs et techniques.
Quant à sa vie personnelle, suite au décès de son épouse, après 30 ans de mariage, il eut un fils, Esteben, de ses secondes noces.
Aujourd'hui il est retraité depuis mai 1993, mais a de nombreuses activités.
De la direction du Syndicat à celle de l'association basque
Euskaldunak
Au printemps 1995, l'association de l'Office Franco-Québécois de la Jeunesse et le Musée de la Civilisation de Québec, le sollicitèrent. Il organisa la venue d'un groupe de danses basques et fit la promotion de la cuisine basque et de la pelote. A l'occasion de cet événement, ils envoyèrent des invitations à tous les basques du Québec, par l'intermédiaire de la presse, pour participer à ce rassemblement au Musée de la Civilisation de Québec. Etant donné le succès remporté par cette cérémonie, l'Association des Basques " Euskaldunak " du Québec naquit.
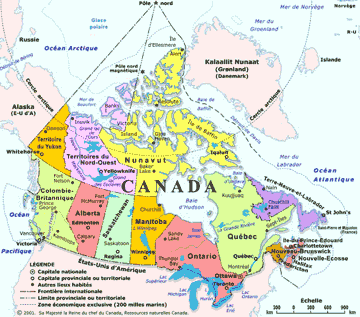 |
Cartes politiques: Interactif
/ normal
Source: Ressources naturelles Canada-Natural Resources Canada |
En 1995, ils ouvrirent les portes du Parc de l'Aventure Basque
en Amérique à Trois-Pistoles. M. Harguindéguy,
pendant 5 ans, assura la gestion de ce parc. Ainsi, les habitants
d'Euskal Herria (Pays Basque) et les Québécois,
ont l'opportunité de visiter, sur les bords du fleuve St-Laurent,
un musée de la pêche consacré aux pêcheurs basques
et d'y trouver un fronton.
Pour terminer, en 1997, il revint dans le monde du syndicat. Jean-Louis Harguindéguy accepta le poste, en qualité de président administratif de la Fédération Indépendante des Syndicats Autonomes. Il s'était engagé pour un an, mais étant donné les événements de ces dernières années (fusions entre pays, etc.) il est toujours en fonction.
Tout de même, Harguindéguy reste dans l'attente de sa retraite officielle. A ce moment-là, il n'y a pas de doute, qu'il aura suffisamment de temps pour animer l'association Euskaldunak, au sein de la ville de Québec et du Pays du Québec aussi !
Conclusion
Le lecteur se rendra compte que ce texte narratif, issu d'une expérience personnelle, est plein de références historiques et de noms de personnalités. Pour cela, nous vous invitons à connaître l'histoire et la situation actuelle de ce pays, en vous connectant sur les sites indiqués plus bas. De cette manière, par l'intermédiaire de l'association " Euskaldunak ", vous aurez l'occasion de connaître mieux grâce aux expériences de Jean-Louis Harguindéguy et à d'autres Basques, l'histoire du Québec.
Voyons, si vous nous faites parvenir d'autres articles sur des Basques du Québec.
A partir de ces sites interactifs, nous avons l'occasion d'apprécier mieux l'histoire et la vie actuelle du Québec.
Xabier Harluxet |