|
Les
conflits interétatiques sont toujours des périodes
difficiles pour les populations. Fort heureusement, durant l’Ancien
régime, elles en étaient exclues car la guerre était
une affaire de professionnels. néanmoins, la vie quotidienne
était perturbée et notamment tout ce qui avait attrait
au commerce puisqu’il était interdit avec les nations ennemis.
Les trois provinces
maritimes basques, le Labourd, le Guipuzcoa et la Biscaye, qui
dépendent étroitement au point de vue économique
de la pêche et du commerce maritime, vont essayer d’élaborer
une solution pour sauvegarder leurs intérêts lorsque
surviendra un conflit entre la France et l’Espagne.
 |
|
Photo:
http://www.saraphina.com |
La solution va
prendre la forme des traités de Bonne correspondance, traités
de commerce et de navigation, inspirés des conventions
de paix passées entre différentes villes du Labourd
et du Guipuzcoa durant le Moyen-Age.
Des historiens
locaux de la fin du XIX° et du début du XX° siècle
se sont intéressés à ces conventions pour
en soulever l’originalité à travers l’étude
des traités eux-mêmes, conservés notamment
aux archives municipales de Bayonne.
Cependant, leur
réalité juridique, plus précisément,
ce qui concerne leur autorité et leur application effective
ne pouvaient être suffisamment perçues par l’étude
seule des traités. La recherche d’autres documents originaux
s’avéraient donc nécessaires. Les archives françaises
vont se montrer beaucoup plus riches que les archives espagnoles,
ayant malheureusement souffert de dispersion ou de destruction.
Outre les fonds contenus aux archives municipales de Bayonne et
de Saint-Jean de Luz, les registres de l’amirauté de Bayonne
(aux archives départementales à Pau) vont apporter
des connaissances nouvelles.

Il existe
sept traités de Bonne correspondance passés entre
la province du Labourd, le gouvernement de Bayonne avec le Guipuzcoa
(et la Biscaye) : deux dans le courant du XVI° siècle (1536-1537),
moins élaborés que ceux du XVII° siècle qui
auront atteint leur maturité normative. Le traité
de 1654 servira d’archétype commun à ceux qui suivront
: 1668,1675, 1690 et 1694.
Ces traités
sont une illustration de l’ingéniosité des Basques
à tirer profit d’une situation défavorable. A l’aide
de ces traités, ils vont obtenir la permission de leur
monarque respectif de continuer leur relation commerciale, normalement
interdite par la guerre qui oppose leurs pays l’un contre l’autre
ainsi que leur commerce international, en toute légalité,
avec l’aide de passeports.
En conséquence,
en période de guerre où les prises de bateaux ou
marchandises ennemis par les corsaires sont légales et
réputées de bonne prise, tout navire basque français
ou espagnol, en possession d’un passeport en cours de validité,
se retrouve exclu des prises. Et si le navire ou la marchandise
venait quand même à être pris, le jugement
sur la validité de la prise serait en faveur de sa restitution.
 Ceci
démontre que l’autorité des traités de Bonne
correspondance dépasse assez largement le cadre purement
local. De plus, les traités fixent une zone de neutralisation
des eaux du golfe en les assimilant à des eaux territoriales
avec des limites très larges. Ceci
démontre que l’autorité des traités de Bonne
correspondance dépasse assez largement le cadre purement
local. De plus, les traités fixent une zone de neutralisation
des eaux du golfe en les assimilant à des eaux territoriales
avec des limites très larges.
Ainsi, ces
traités font état de concepts en matière
de droit international nettement en avance sur leur temps et traduisent
une grande autonomie dont ces provinces pouvaient encore jouir
à la fin du XVII° siècle. Les traités de
Bonne correspondance disparaîtront au cours du XVIII° siècle
en raison de la raréfaction des conflits franco-espagnols
mais également en raison de la montée de protectionnisme
du côté espagnol et de conflits qui opposeront de
plus en plus les provinces signataires elles-mêmes entraînant
la détérioration de leur relation économique
et la disparition de l’esprit de la bonne correspondance.
Caroline Lugat,
Faculté
pluridisciplinaire de Bayonne/Anglet/Biarritz
Photos: http://www.basque-eurocity.org | 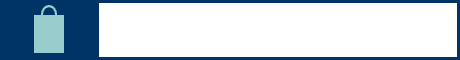



 Ceci
démontre que l’autorité des traités de Bonne
correspondance dépasse assez largement le cadre purement
local. De plus, les traités fixent une zone de neutralisation
des eaux du golfe en les assimilant à des eaux territoriales
avec des limites très larges.
Ceci
démontre que l’autorité des traités de Bonne
correspondance dépasse assez largement le cadre purement
local. De plus, les traités fixent une zone de neutralisation
des eaux du golfe en les assimilant à des eaux territoriales
avec des limites très larges.