|
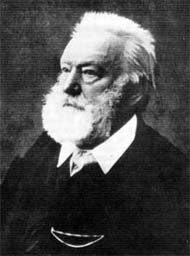 En
été 1843, Victor Hugo entreprend un voyage vers
les Pyrénées. Le tourisme, invention anglo-saxonne
toute récente, privilégie en effet cette région
du sud-ouest de la France. Comme son ami Mérimée
quelques années auparavant (1838), Hugo met donc cap vers
le sud, soucieux de retrouver le plaisir qu’il avait connu lors
de ses excursions dans les Alpes, ou bien encore le long du Rhin. En
été 1843, Victor Hugo entreprend un voyage vers
les Pyrénées. Le tourisme, invention anglo-saxonne
toute récente, privilégie en effet cette région
du sud-ouest de la France. Comme son ami Mérimée
quelques années auparavant (1838), Hugo met donc cap vers
le sud, soucieux de retrouver le plaisir qu’il avait connu lors
de ses excursions dans les Alpes, ou bien encore le long du Rhin.
S’il désire
se remettre de l’échec des Burgraves survenu l’hiver
précédent et s’échapper de Paris et
de sa situation familiale compliquée – vie partagée
entre son épouse Adèle et sa maîtresse Juliette,
qui va l’accompagner en Espagne – Victor Hugo souhaite également
retrouver les émotions de l’enfance. En effet, l’écrivain
a la nostalgie de son enfance espagnole. Son père, général
de Napoléon, avait servi en Espagne, et sa famille l’avait
rejoint à Madrid en 1811 et 1812.
Victor Hugo quitte
donc Paris le 18 juillet 1843. Il traverse les Landes le 23 juillet
– il apprend alors la chute d’Espartero -, puis séjourne
quelques jours à Bayonne. Les souvenirs d’enfance ressurgissent :
Bayonne où il avait séjourné un mois avec
sa mère et son frère Eugène, alors qu’ils
se rendaient à Madird. (Deux souvenirs se dégagent
particulièrement : on donne au théâtre
les Ruines de Babylone, mélodrame de Pixérécourt,
auquel le jeune Hugo assiste à plusieurs reprises ;
et l’ « angélique figure » d’une jeune fille
de 14-15 ans qui lui faisait la lecture.) Une escapade à
Biarritz le 25 juillet coupe ces moments passés à
Bayonne.
Puis Hugo prend la
direction de l’Espagne le 27 juillet, par Irun et Fontarabie.
Il se rend à Saint-Sébastien, puis Pasages, où
il loge chez Mme Basquetz. Il contemple la baie, l’agitation du
port, fait de longues promenades. Il visite le village dévasté
de Lezo, puis se rend vers Tolosa, Ernani, enfin Pampelune.
De retour à
Bayonne le 13 août, il se rend à Pau, Cauterets,
Gavarnie, puis Luz. Enfin il prend le chemin du retour à
Paris en passant par Auch, Agen, Périgueux et Rochefort,
où Victor Hugo apprend par hasard, en lisant une gazette
qui traînait sur la table d’un café, que sa fille
Léopoldine s’est noyée.
C’est la fin du voyage.
Deuil et désolation succèdent à l’enthousiasme
de la (re)découverte.
Durant son voyage,
Victor Hugo avait pris des notes et tenu une sorte de journal
de bord, de relation de voyage. Certaines parties sont entièrement
rédigées, d’autres sont constituées de brèves
notations. On compte aussi une lettre. Une publication posthume
de cet ensemble de textes sous le titre de Voyage vers les
Pyrénées verra le jour en 1890.
On connaît
l’intérêt des romantiques pour les littératures
étrangères, et l’on sait que dans ses œuvres, Hugo
recourt fréquemment à des vocables étrangers.
Je voudrais aujourd’hui m’intéresser à l’emploi
des langues basque et espagnole dans le texte du Voyage vers
les Pyrénées.
On notera tout d’abord
que Victor Hugo n’emprunte pas seulement aux langues des pays
qu’il traverse. De façon paradoxale peut-être, il
cite également d’autres langues, qui n’ont aucun rapport
avec le lieu géographique dans lequel il se trouve. L’italien
par exemple, est réservé à quelques citations
d’ordre littéraire. Un mot en anglais a son importance :
le mot tourist, d’invention récente. (Il est amusant
de constater que ce terme intervient dans le contexte du séjour
de Hugo à Pasages, « petit éden rayonnant »
qu’aucun tourist ne visite ».) Figurent également
deux syllabes en anglais relevées sur le mur de la maison
qu’habite Hugo à Pasages : old/cold, survivances
de « quelque enseigne de marchand ». Des références
au béarnais sont également lisibles à la
fin du Voyage. Enfin de nombreux passages en latin émaillent
le texte.
LA LANGUE BASQUE
On sait grâce
à la correspondance de Victor Hugo (Lettre à Charles
Hugo datée du 31 juillet 1843) que Hugo a fait l’acquisition
d’une grammaire basque, destinée à l’aider dans
son apprentissage de la langue, et sans doute de satisfaire sa
curiosité :
« Je suis ici
[Saint-Sébastien] à peu près en Espagne,
étudiant une grammaire basque qui m’a coûté
quatre réaux, en parlant espagnol avec les curés
et les servantes d’auberge comme si je n’avais fait autre chose
toute ma vie. Je n’étais pas en Espagne depuis deux heures
que tout mon espagnol de 1813 me revenait, et je me suis remis
à barboter en plein castillan comme un poisson vivant qu’on
rejette à l’eau et qui se remet à nager. »
Peu d’euskara dans
le texte : une dizaine de mots et expressions seulement sont
utilisés par Hugo. Sans doute ce dernier n’a-t-il pas eu
le temps de mettre à profit la grammaire basque qu’il avait
achetée ! Ces expressions représentent une
difficulté pour le lecteur, obligé de s’imaginer
le sens de ces mots, qu’Hugo n’indique pas toujours. Ces mots
sont prononcés par des personnages de rencontre, deux pâtres
dans la montagne :
Iguraldia gaiztoa.
Jaincoa berorrecrequin.
Ahuatlacouata !
ou bien par Hugo
lui-même, en « basque médiocre » comme
il l’avoue :
Buy,
bicho nequesa.
Un dialogue entre
montagnards basques – bien laconique – est entièrement
traduit par Hugo :
Zuec ? – Gue. – Nu ?
– Emen. – Cembat ? – Lau.
Vous ? – Nous. –
Où ? – Ici. – Combien ? – Quatre.
On relève
encore quelques expressions :
Adisquidea. (Traduit par
Hugo : Un ami.)
Guiltza (traduit :
la clef)
Bay (traduit :
oui)
Ce ne sont que peu
de mots, mais une ambiance est créée, grâce
également à l’usage de noms propres, personnages
(Escumuturra, Irumberri, Azcoaga) ou toponyme (Astigarraga).
Il il reste que la
moisson basque est bien maigre dans ce Voyage de Victor
Hugo, pourtant fortement impressionné par cette région
qu’il traverse, et qui cisèle tout de même en termes
très hugoliens uen définition de l’euskara : « La
langue basque est une patrie, j’ai presque dit une religion. Dites
un mot basque à un montagnard dans la montagne ; avant
ce mot, vous étiez à peine un homme pour lui ;
ce mot prononcé, vous voilà son frère. »
LA LANGUE ESPAGNOLE
On relève
davantage de mots ou expressions en langue espagnole et l’on perçoit
un véritable plaisir de la citation en espagnol. Sans doute
s’agit-il là d’une mise en œuvre du pacte référentiel,
propre à la littérature de voyage.
Les termes espagnols
auxquels Hugo a recours permettent tout d’abord de situer le Voyage,
d’un point de vue historique et géographique. C’est la
couleur locale chère aux dramaturges du XIXe siècle,
destinée à donner vérité et originalité
à la peinture, à créer une ambiance grâce
à des notations concernant la vie quotidienne.
Ainsi Hugo jalonne
son texte des noms des villes ou régions qu’il traverse.
Poésie de la langue, exotisme, souci de dépayser
le lecteur autant que l’écrivain, rejoignent l’ambition
encyclopédique. Toutefois seuls le « Passage »
et Pampelune sont déclinés en espagnol et en français
(Pamplona, Pamapelune, Pasages, El otro Pasage, le Passage,
les Passages), les autres toponymes étant francisés
(Fontarabie, Saint-Sébastien, Castille-Vieille) ou livrés
tels quels (Ernani, Irun, Leso, Renteria).
Les villes sont parfois
accompagnées du nom de la rivière qui les traverse
et qui garde son nom espagnol : Araxa, Arga, Arlanza, Bidassoa,
Oria, Urumea. Victor Hugo ne fait guère preuve d’originalité
pour dépeindre ces rivières, qui sont invariablement
« jolie », ou « belle ».
Hugo donne aussi
les noms des montagnes, des monts : Arun, Jaitzquivel, Urgoll.
Si Hugo s’épanche
dans quelques descriptions, laissant place aux senitments, impressions
et sensations du voyageur, la topographie est surtout prétexte
à évoquer l’histoire. Le monument rappelle les civilisations
disparues. On notera le souci didactique de Hugo de retracer l’histoire
du pays qu’il découvre, son histoire contemporaine, mais
également plus lointaine.
L’histoire jaillit
en fonction du lieu traversé ou seulement même évoqué.
Hugo nous transporte au Siècle d’Or : Guetaria, ville natale
de Sébastien de Elcano « qui fit le tour du monde
en 1519 (notez la date) » ; venant d’Allemagne, débarquant
à Loredo « pour Saint-Just, Charles Quint qui d’empereur
se fit moine » : l’ile des faisans est l’occasion
de retracer une autre scène, lieu où « la maison
de France a épousé la maison d’Autriche, où
Mazarin, l’athlète de l’astuce, a lutté corps à
corps avec Louis de Haro, l’athlète de l’orgueil ».
Motrico est la « patrie de Churruca qui mourut à
Trafalgar ». Le voyageur regrette de ne trouver trace à
Ernani de la maison natale de Jean de Urbuta « ce capitaine
espagnol auquel échut, dans la journée de Pavie,
l’honneur de faire François 1er prisonnier.
Urbuta fit la chose en gentilhomme et François 1er
la subit en roi. »
Philippe II rappelle
une sombre époque et stimule l’imagination de l’écrivain.
Lorsqu’Hugo se trouve « au Passage », celui qui est
vu « du côté de la montagne » et non « du
côté de l’eau » : « Vous entrez, vous
êtes chez les hildagos, vous respirez l’air de l’Inquisition,
vous voyez se dresser à l’autre bout de la rue le spectre
livide de Philippe II. » L’impression se confirme un peu
plus tard à l’église de Leso où « les
formidables saints de l’Inquisition [sont] mêlés
à l’architecture tragique et sinistre de Philippe II ».
Mais c’est surtout
l’histoire contemporaine qui intéresse Hugo. Son père,
le général Hugo, avait servi la maison Bonaparte.
Quelques souvenirs de cette époque sont lisibles dans le
texte : la mention des deux Castilles, administrées
par Joseph 1er ; les provinces d’Avila et
Guadalaxara, provinces insurgées que le général
Hugo était chargé de « tenir en respect ».
Mais la fin de l’année
1813 vit la Restauration de la maison des Bourbons. Hugo vit en
direct la première guerre carliste. Cette guerre civile,
d’origine à la fois dynastique et politique, opposa les
Carlistes (traditionnalistes, partisans de Don Carlos, frère
de Ferdinand VII qui prétendait au trône sous le
nom de Charles V) aux christinistes (libéraux, partisans
de la régente Marie-Christine). Hugo parle des carlistes
et des cristinos et cite plusieurs acteurs de cette
guerre civile, parmi lesquels se détachent particulièrement
Espartero, Zumalacarrégui et Don Carlos.
En effet, Hugo s’attarde
longuement sur don Carlos, véritable héros romanesque.
Il décrit son entourage : « Il y avait deux partis
autour de don Carlos, le parti de la cour, el rey neto,
et le parti des droits, los fueros ». Il ne peut s’empêcher
de dénoncer la mauvaise influence du Père Larranaga,
confesseur de Don Carlos. Il mentionne encore la Princesse de
Beïra sa femme, le prince des Asturies, héritier de
la couronne, fils de don Carlos.
Hugo souligne le
charisme du général Tomas de Zumalacarrégui,
chef carliste tué en 1835 (« nœud du faisceau carliste »
selon Hugo.) véritable héros, et atout principal
de Don Carlos.
Enfin il évoque
la trahison de Maroto, qui obligea don Carlos à se réfugier
en France le 31 août 1839.
Hugo décrit
deux guerres civiles qui se succèdent : « la
guerre civile d’Espartero après la guerre civile de don
Carlos ». Mais il ne ressent aucune admiration pour Espartero,
plutôt du mépris. Parmi les « Notes sur l’Espagne » on
peut lire :
Oh ! Si cette
grande nation trouvait un grand homme, comme elle ferait de
grandes choses ! quelle misère ! avoir besoin
d’un Napoléon et tomber sur un Espartero !
En traversant les
Landes, au début de son voyage, Hugo a eu le pressentiment
de la chute d’Espartero, sorte de sixième sens politique
:
Un souffle de révolution
semblait agiter ces vieux pins.
C’était l’instant
précis où Espartero s’écroulait en Espagne.
Il rend compte de
la dégradation du politique, qui se corrompt dans la bouche
du postillon : « Espartero a pris Lafuite et Caillard ».
Phrase énigmatique, qui doit sans doute être comprise
comme « Espartero a pris la fuite et doit se taire (callar
en espagnol) ».
Il résume
ailleurs laconiquement ces changements politiques :
« Espartero qui tombe,
Narvaez qui surgit, Lopez qui chasse Mendizabal ».
Hugo livre une définition
inattendue du pronunciamento , coup d’Etat militaire au
cours duquel le chef des rebelles prononce un discours-programme,
pour entraîner ses partisans, et décrit la « petite
révolution antiespartériste » de Saint-Sébastien :
Les
principaux de la ville se sont réunis à l’ayuntamiento ;
on a convoqué les deux officiers de chaque compagnie
de la milice urbaine ; on a dressé dans une salle
une table avec un tapis vert ; sur cette table on a rédigé
une chose quelconque, on a lu cette chose par une fenêtre
aux passants qui étaient dans la place ; quelques
enfants qui jouaient aux marelles se sont interrompus un instant
et ont crié « Vivat ». Le soir même
on a signifié cet événement à la
garnison qui était dans le castillo. La garnison
a adhéré à la chose écrite sur la
table de la mairie et lue à la fenêtre de la place.
Le lendemain le général a pris la poste, le surlendemain
le chef politique a pris la diligence, deux jours après
le colonel s’en est allé. La révolution était
faite.
On
sera sensible à la dimension politique de ces propose :
le Pays Basque fascine Hugo, par son indépendance, sa résistance,
son goût de la liberté, « l’antique liberté
basque ». Hugo réfléchit longuement, s’interroge
sur la contradiction basque. Pourquoi le Guipuzcoa, « pays
des droits, nations des fueros », a-t-il accueilli
« la royauté effrayée et traquée » ?
Pourquoi « la vieille république guipuzcoane »
soutient-elle « le vieux despotisme castillan contre
la constitution de 1812 » ?
Enfin Hugo, européen
dans l’âme, tisse des équivalences entre les nations lorsqu’il
décrit :
une rampe de pierre
massive admirablement ouvrée dans ce goût sombre
et élégant de Charles Quint qui répond
à ce que nous nommons en France le style François
1er, et à ce qu’on nomme en Angleterre l’architecture
Tudor.
Sur ce fond historique
se déroule le voyage ordinaire de notre écrivain,
avec ses difficultés de transport, ses problèmes
de communication ou d’argent, ses préoccupations concernant
le logement. Ici se manifeste le goût de Hugo pour le pittoresque,
les anecdotes piquantes.
Hugo se heurte à
l’administration, qu’il brocarde volontiers. Les premiers rencontrés
sont les Cazadores de Guipuzcoa. « le cazador ne sait
guère que courir sur la route, porter un fusil et demander
l’aumône ».
Il s’amuse au sujet
du passeport :
A chaque instant il s’envole de
votre poche, se déplie et disparaît. Courez après.
Il est à la gefetara ?
Puis à la politica ?
Puis en casa del alcade !
Puis al alyuntamiento.
Puis à la referendacion.
Et chaque fois une media-peseta. »
Les moyens de transport
sont très importants pour un voyageur. Hugo emprunte les
diligences : Diligencias peninsulares, ou bien Coronilla
de Aragon. Le voyage qu’il fait de Tolosa à Pampelune
est décrit de façon détaillée, grossi
à la dimension d’une épopée.
Hugo mentionne les
trois conducteurs, dont un enfant de « huit à neuf ans » :
« Figurez-vous un démon traînant le tonnerre. » Il
nomme le Mayoral et le Sagal. « Qui n’a pas
vu courir un sagal navarrais sur la route de Tolosa à
Pampelune ne sait pas tout ce que contient le fameux proverbe :
« Courir comme un basque. »
Les mules frappent
fortement l’imagination de Hugo, qui retient leurs noms :
La capitana ! la gaillarde ! la generale ! Leana !
la carabinera ! la collagiana ! la carcana !
Elles deviennent
de véritables créatures infernales et Hugo,
décrivant leur guarda-ojos , s’apitoie longuement
sur leur sort.
Hugo s’intéresse
beaucoup aux échanges, qu’ils soient verbaux ou commerciaux.
Il décrit la monnaie du pays (Peseta, Quarto, Media
peseta, Real). Il se livre à l’occupation favorite
du touriste : faire les boutiques, rapporter des souvenirs.
« Dans les villes
d’Espagne, il y a beaucoup de ventas, c’est-à-dire
beaucoup de cabarets, quelques posadas, c’est-à-dire
quelques auberges, et fort peu de fondas, c’est-à-dire
fort peu d’hôtels. »
Il cite quelques
noms de boutique : Posada Lhabit, Fonda Ysabel, déchiffre
une devanture de magasin : Vino y aceite.
Les noms de ville
se voient associer leurs productions (Bilbao : bénitiers
en verre ; Pampelune : muleta ; Ségovie :
jarretières à devise ; Saragosse : amulettes
en or, en vermeil ; Tolosa : papier ; Urbieta :
fabrique de chapeaux ; Elizondo : chandelles).
Il s’attarde sur
quelques éléments du paysage, Castillo, Plaza de
la Constitucion. Il explique au lecteur ce que veut dire :
Al segundo piso (traduit par Hugo : au second étage) ;
El matrimonio (expliqué par Hugo : un lit large).
Mais il se livre
surtout au plaisir de conter et rapporte quelques conversations
qu’il a eues avec les habitants. Il glane çà et
là quelques expressions typiques :
(Andamos ; Amigo ;
Señor estrangero, conoce usted cette chanson ? Que
pensa usted de Don Carlos ? Vamos ; Señor frances,
benga usted con migo ! – Con migo, caballero ! - Ven
hombre, may bonita soy ! Que es eso ? Anda, nial ;
And’usted ; Caballero ! Señor caballero !
El niño, el chiquito frances ; Un loco !)
Il dénomme
ses personnages : Muchacha, Muchachas ; Querido ;
Mozzo ; Contrabandistas.
Il insiste sur le
caractère superstitieux des Espagnols, comme le confirme
la scène qui se déroule avec les lavandières :
« Mieux vaudrait jaser avec les quatre démons du levant
et du couchant, du nord et du midi. » plutôt que parler
avec un Français !
Il décrit
ainsi cette scène étrange qui se déroule
à Pasages, et l’écriture elliptique accentue le
côté terrifiant de la scène :
Le soir, danse,
rires, guitares. Tout à coup, une sonnette passe et une
voix dit : « Paralme almas del purgaterio. »
Tout le monde tombe à genoux.
Quelques métiers
sont évoqués, les Serenos de Pampelune, entendus
par Hugo, ou « Saturnino, Ropero » et « Fermin,
Sastre », sur une devanture de boutique.
Hugo
se montre plutôt discret en ce qui concerne la gastronomie
ou les vêtements. Seuls quelques termes sont empruntés
à l’espagnol (Olla podrida ; Verros ; Rosquillas ;
De la langosta ; Sombreros ; Muletas). Il évoque
très rapidement une scène de corrida, à l’occasion
de la description de la plaza de la Constitucion à Pasages
(Corrida, Novillos, Muchares, célèbre espada).
Ces termes espagnols
glissés dans le texte agrémentent les saynètes
retranscrites par Hugo, comme l’épisode des bateleras
ou des lavandières.
Mais la découverte
– redécouverte – d’une région n’empêche pas
notre écrivain de se livrer à son occupation favorite :
la recherche des ruines, la réflexion sur le passé.
Victor Hugo, véritable « antiquaire », est à
l’affût de la moindre inscription. Ainsi sur cette maison
de Pasages :
« Una limosna
para / Alumbrar al Sto Cto / D. Buen Biaje /Año 1756 ».
Traduit par Hugo : « Une
aumône pour éclairer le Saint-Christ du bon voyage.
An 1756. »
Sur l’église de Pasages,
« maussade » : « Manuel Martin / Carrera me
hizo / Año 1774 ».
A Tolosa, Hugo n’aura pas le
loisir de recopier intégralement une inscription sur marbre
noir à la devanture d’une maison, en raison d’un attroupement
qui se forme autour de lui : « Sic visum superis ….
el emperador le armo caballero ».
A Pampelune, Hugo relève
de nombreuses inscriptions, parmi lesquelles :
« El Eminen Mo Sr Cardenal
Pereira concedio 80 dias de yndulgen a y el Sr obispo Murillo
40 al que rezare una salve de rrodillas de lane esta Sma ymagen
de Nra Sra de el Amparo ».
Même en France, Hugo
prend note d’une inscription en espagnol :
« Lo que ha de se no puede
faltar ».
Hugo ajoute : « on
sent le voisinage de l’Espagne ».
Dans le désir
de remonter le temps, d’établir un lien entre passé
et présent, Hugo s’interroge sur un toponyme, son étymologie.
Dans ce pays « où l’on prononce b pour v ;
ce dont s’extasiait cet ivrogne de Scaliger : « Felices
populi, s’écriait-il, quibus VIVERE est BIBERE. »,
tout est prétexte pour Hugo à une réflexion
philologique.
Aranjuez, « ara jovi,
jovis ara » est rapproché de deux villes françaises,
Jouarre en Champagne, Jouarare dans les Landes.
Fontarabie laisse Hugo
songeur. Le nom veint-il de « fuente à rabbia, fontaine
qui guérit la rage, ou de fuente a raba , fontaine
arabe, ou de fuente a rabbi, fontaine à rabbin à
cause des ablutions qu’y faisaient les Juifs » ?
Si l’étymologie de Pasages est
facile à retrouver, le passage, celle de Pampelune résiste
davantage : « ville vasconne selon les uns avec le nom antique
de Pompelon, ville romaine selon les autres avec Pompée
pour fondateur ».
Cette préoccupation
ne le quitte pas lorsqu’il se trouve sur le sol français :
Luz vient de l’espagnol
« lumière », Castelloubon du béarnais
« le Bon-Château », Cap Breton du latin « caput
Bruti ».
Enfin l’intérêt
de Hugo pour la langue, sa musique, se manifeste également
dans l’attention portée aux chansons populaires, véritables
éléments du patrimoine littéraire. Hugo,
devant un bas-relief du 14 e siècle qu’il admire à
Pampelune se remémore « La belle romance castillane
qui commence ainsi :
Bernard, la lance
au poing, suit en courant les rives de l’Arlanza. Il est parti
l’Espagnol gaillard, vaillant et déterminé. »
A Biarritz, il entend une baigneuse
fredonner :
« Gastibelza, l’homme à
la carabine
Chantait ainsi :
Quelqu’un a-t-il connu dona
Sabine
Quelqu’un d’ici ?
Dansez, chantez villageois,
la nuit gagne
Le mont Falú.
Le vent qui vient à
travers la montagne
Me rendra fou »
(poésie d’ailleurs
reprise des Rayons et des ombres) et se compare à
« Ulysse écoutant la sirène ».
Enfin il propose une traduction
à :
Gentil muchacha
Toma la derecha.
Hombre de noda
Toma la izquierda.
Fille adroite,
Prends la droite.
Homme gauche,
Prends la gauche.
Hugo se nourrit véritablement
de ces « choses vues » lors de son voyage dans les Pyrénées.
Il renoue avec l’enfance, avec l’inspiration. Et son émerveillement
est perceptible à travers l’usage des langues basque et
espagnole.
Il décrit
notamment avec beaucoup de justesse ce pays basque pour lequel
il se prend d’affection, pays de transition, à l’image
de sa rivière, la Bidassoa, « jolie rivière
à nom basque, qui semble faire la frontière de deux
langues comme de deux pays et garder la neutralité entre
le français et l’espagnol ».
Plus loin il emploiera
la métaphore de la danse pour décrire ce « pays
mixte », « ni France ni Espagne, ni mer ni rivière »
:
On [y] parle
bien un peu castillan, mais on parle surtout bascuence.
Les femmes ont la mantille, mais elles n’ont pas la basquine.
[…] On danse le soir sur la pelouse en faisant claquer ses
doigts dans le creux de sa main ; ce n’est que l’ombre
des castagnettes. Les danseuses se balancent avec une souplesse
harmonieuse, mais san verve, sans fougue, sans meportement,
sans volupté ; ce n’est que l’ombre de la cachucha.
Mais ces notes, ces
souvenirs, ne seront pas exploités autant qu’ils auraient
pu l’être, en raison de l’événement tragique
qui mettra fin au voyage. La mort de Léopoldine recouvre
d’une sorte de voile sombre tous ces moments, que seule une publication
posthume permettra de faire connaître.
Véronique
Duché, Professeur de
Lettres et Littérature française à la Faculté
Pluridisciplinaire de Bayonne
Photos: Auñamendi |
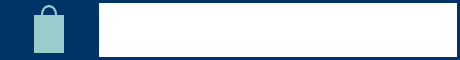

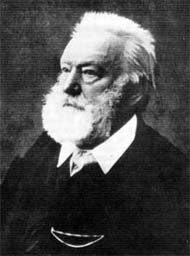 En
été 1843, Victor Hugo entreprend un voyage vers
les Pyrénées. Le tourisme, invention anglo-saxonne
toute récente, privilégie en effet cette région
du sud-ouest de la France. Comme son ami Mérimée
quelques années auparavant (1838), Hugo met donc cap vers
le sud, soucieux de retrouver le plaisir qu’il avait connu lors
de ses excursions dans les Alpes, ou bien encore le long du Rhin.
En
été 1843, Victor Hugo entreprend un voyage vers
les Pyrénées. Le tourisme, invention anglo-saxonne
toute récente, privilégie en effet cette région
du sud-ouest de la France. Comme son ami Mérimée
quelques années auparavant (1838), Hugo met donc cap vers
le sud, soucieux de retrouver le plaisir qu’il avait connu lors
de ses excursions dans les Alpes, ou bien encore le long du Rhin.