|
 "A
Pasages, on travaille, on danse et on chante. Quelques uns travaillent,
beaucoup dansent, tous chantent ", écrit Victor Hugo en
1843 à l’occasion de son séjour au Pays Basque.
Le chant est couramment considéré aujourd’hui comme
une spécificité basque, et l’on a limpression qu’il
en est ainsi depuis "toujours". Or, si les Basques ont probablement
"toujours" chanté, on n’a prêté attention
à ce chant que depuis le XIXème siècle ce
qui est finalement assez récent. Auparavant, les Basques
sont réputés pour leurs capacités physiques
(agilité, souplesse, endurance) qui en font des danseurs,
des joueurs de paume, des laquais (utilisés comme coursiers)
et des militaires appréciés. Certes, il se dit que
les Romains avaient remarqué leurs talents vocaux, mais
le "Basque chanteur" ou le "chanteur basque" n’est pas considéré
comme un type représentatif du pays, et les "chants basques"
n’ont pas d’existence en tant que répertoire particulier.
Peu à peu, à partir des années 1800, les
choses se modifient : une notion de "chant basque" apparaît,
très tributaire des mouvements de pensée qui agitent
l’Europe à ce moment-là, et elle devient, au début
du XXème siècle, l’une des composantes majeures
de l’identité basque. Examinons quelques étapes
de ce processus. "A
Pasages, on travaille, on danse et on chante. Quelques uns travaillent,
beaucoup dansent, tous chantent ", écrit Victor Hugo en
1843 à l’occasion de son séjour au Pays Basque.
Le chant est couramment considéré aujourd’hui comme
une spécificité basque, et l’on a limpression qu’il
en est ainsi depuis "toujours". Or, si les Basques ont probablement
"toujours" chanté, on n’a prêté attention
à ce chant que depuis le XIXème siècle ce
qui est finalement assez récent. Auparavant, les Basques
sont réputés pour leurs capacités physiques
(agilité, souplesse, endurance) qui en font des danseurs,
des joueurs de paume, des laquais (utilisés comme coursiers)
et des militaires appréciés. Certes, il se dit que
les Romains avaient remarqué leurs talents vocaux, mais
le "Basque chanteur" ou le "chanteur basque" n’est pas considéré
comme un type représentatif du pays, et les "chants basques"
n’ont pas d’existence en tant que répertoire particulier.
Peu à peu, à partir des années 1800, les
choses se modifient : une notion de "chant basque" apparaît,
très tributaire des mouvements de pensée qui agitent
l’Europe à ce moment-là, et elle devient, au début
du XXème siècle, l’une des composantes majeures
de l’identité basque. Examinons quelques étapes
de ce processus.
C’est un Allemand
(Wilhelm von Humboldt, ambassadeur du roi de Prusse et philologue
de renom) qui publie le premier "chant national basque", qui est
un texte en euskara, supposé chanté à l’origine,
et que l’on estime alors remonter à l’Antiquité
: le Chant de Lelo paraît en 1817, à Berlin.
Au début du XIXème siècle, les érudits
s’intéressent tout spécialement à ce qu’ils
appellent " l’histoire primitive ", l’histoire des peuples qui
sont à l’origine des nations européennes - dont
beaucoup vont se constituer en états au cours du siècle.
Or les documents écrits sont pratiquement inexistants.
Mais l’on pense que des récits de ces temps reculés
sont quand même parvenus jusqu’à nous, notamment
par l’intermédiaire des chants populaires, transmis oralement.
L’Europe savante se passionne alors pour cette quête de
chants anciens : c’est à qui mettra la main sur le manuscrit
médiéval ou la ballade populaire la plus intéressante,
dont on considèrera uniquement le texte puisqu’on y cherche
des informations d’ordre historique et parfois philologique.
Puisque l’on cherche
des chants épiques et guerriers (synonymes, à cette
époque, d’historiques), on va en trouver. Au Pays Basque,
par exemple, le littérateur Eugène Garay de Monglave
fait paraître en 1834, trois ans avant que l’on ne retrouve
la fameuse Chanson de Roland, une relation de la bataille
de Roncevaux par les descendants des protagonistes : c’est du
moins ce qu’est censé être le Chant dAltabiscar.
"La trouvaille que vous avez faite vaut de lor ! ", s’exclame
un historien dans un journal parisien. Paraissent ensuite le Chant
dAnnibal, récit d’un soldat basque amené en
Italie par le général carthaginois, et le Chant
dAbarca, adressé par un seigneur de Belzunce au roi
de Navarre Sancho Abarca qui vécut au Xème siècle.
Mais tous ces chants
sont apocryphes : le Chant de Lelo provient d’un manuscrit
copié au XVIème siècle, les autres sont carrément
l’oeuvre de faussaires contemporains qui ont prétendu les
avoir découvert ou recueilli dans la montagne. En attendant
que la supercherie soit découverte (le doute alimente les
revues européennes d’histoire et de linguistique pendant
presque un demi-siècle), le "chant national ", que l’on
commence à appeler "chant basque" lorsqu’il émane
des provinces euskariennes, s’affirme comme une catégorie
reconnue dans le monde lettré. Parallèlement, une
autre acception de ce terme se fait jour : il désigne aussi,
pour reprendre la définition donnée par G. Ollivier
dans le Dictionnaire de la conversation en 1833, "toute
mélodie qui porte empreints la nationalité d’un
peuple, ses murs, ses jeux, ses usages, ses traditions et ses
croyances ", ce qui représente un corpus beaucoup plus
large que les seuls chants historiques. On l’appelle aussi couramment
"chant populaire ", et plus souvent encore " poésie populaire
" car, contrairement à ce que la formulation de G. Ollivier
laisse supposer, on ne prend en compte que le texte, et non la
musique.
Les recueils se succèdent
et enthousiasment les lecteurs européens : des traductions
de chants grecs et serbes, en particulier, bouleversent les canons
littéraires classiques dans les années 1820 et participent
à la révolution romantique. " Après cela,
il n’y a pas à douter que la poésie populaire ne
devînt une source féconde et réparatrice pour
la poésie d’art ", estime Francisque Michel. Ce professeur
de littérature étrangère à l’université
de Bordeaux consacre en 1857 deux cents pages aux "poésies
populaires" dans son ouvrage Le Pays Basque : il désire
permettre au lecteur de se forger une opinion sur ce corpus inédit,
qui a été jugé sans qualité littéraire
par un aventurier et missionnaire anglais, George Borrow.
Quelques années
après la publication du premier texte paraît (à
Paris cette fois) le premier air populaire, dans un arrangement
pour voix et piano ou harpe dû au compositeur français
Gustave Dugazon. Il est muni de paroles françaises différant
du texte original, et porte le titre de Souvenir des Pyrénées
(1824). Puis, en 1826, à Saint- Sébastien,
un danseur passionné, également historien de sa
province, Juan Ignacio de Iztueta publie un recueil de mélodies
de danses dont une partie sont chantées. Dans sa préface,
il expose l’intérêt que présente à
son avis ce que l’on appellera bientôt le folklore, dans
la perspective d’études historiques comparées, mais
dénie aux chansons qu’il publie toute dimension artistique
: "prétendre [trouver] dans les chants vulgaires les combinaisons
sublimes de l’art serait une erreur grossière", écrit-il.
Cette opinion est assez largement partagée. Georges Amé,
par exemple, le jeune étudiant féru de musique à
qui F. Michel s’est adressé pour une appréciation
"compétente" du livre d’Iztueta, est dérouté
: "dans certains de ces chants, le vague et la bizarrerie sont
tels que j’ai cru avoir devant les yeux de véritables énigmes
", avoue-t-il. Quelques voix ont commencé à s’élever
cependant (en particulier celles d’Anglais qui publient, vers
1840, des récits de voyage agrémentés de
musique notée) pour défendre l’intérêt
musical, et non plus uniquement littéraire, de ce répertoire. Sébastien,
un danseur passionné, également historien de sa
province, Juan Ignacio de Iztueta publie un recueil de mélodies
de danses dont une partie sont chantées. Dans sa préface,
il expose l’intérêt que présente à
son avis ce que l’on appellera bientôt le folklore, dans
la perspective d’études historiques comparées, mais
dénie aux chansons qu’il publie toute dimension artistique
: "prétendre [trouver] dans les chants vulgaires les combinaisons
sublimes de l’art serait une erreur grossière", écrit-il.
Cette opinion est assez largement partagée. Georges Amé,
par exemple, le jeune étudiant féru de musique à
qui F. Michel s’est adressé pour une appréciation
"compétente" du livre d’Iztueta, est dérouté
: "dans certains de ces chants, le vague et la bizarrerie sont
tels que j’ai cru avoir devant les yeux de véritables énigmes
", avoue-t-il. Quelques voix ont commencé à s’élever
cependant (en particulier celles d’Anglais qui publient, vers
1840, des récits de voyage agrémentés de
musique notée) pour défendre l’intérêt
musical, et non plus uniquement littéraire, de ce répertoire.
Un Béarnais,
notamment, entreprend de porter les chants basques et béarnais
sur la scène de concert : pendant une trentaine d’années,
Pascal Lamazou les interprète et les inclut dans le programme
de son récital annuel donné à Paris, salle
Pleyel. Et en 1869 paraissent les premiers recueils : Cinquante
chants pyrénéens de P. Lamazou, mais aussi Souvenirs
des Pyrénées de Madame de la Villehélio,
une Souletine née Hortense Carricaburu. A Paris, on ne
connaît donc pas encore les "chants basques", mais les "chants
 pyrénéens
", profitant du penchant romantique pour la montagne, devenue
un thème littéraire et pictural, et un lieu de villégiature
touristique et thermale. L’année suivante, à Bayonne,
un avocat de Mauléon, J.D.J. Sallaberry, publie ses Chants
populaires basques. A Saint-Sébastien, José
Antonio Santesteban réunira bientôt en recueil les
Aires vascongados qu’il a commencé à faire
paraître isolément à Paris à partir
de 1862. pyrénéens
", profitant du penchant romantique pour la montagne, devenue
un thème littéraire et pictural, et un lieu de villégiature
touristique et thermale. L’année suivante, à Bayonne,
un avocat de Mauléon, J.D.J. Sallaberry, publie ses Chants
populaires basques. A Saint-Sébastien, José
Antonio Santesteban réunira bientôt en recueil les
Aires vascongados qu’il a commencé à faire
paraître isolément à Paris à partir
de 1862.
Ces publications
adoptent la même démarche : notation solfégique,
paroles basques et traduction française (sauf pour les
airs de J.A. Santesteban), accompagnement au piano (par des compositeurs
renommés dans le cas du recueil de Lamazou) destiné,
nous dit une préface à "relever » la mélodie
populaire, "la prenant simple fille des champs et l’introduisant
dans les salons, de par l’imprescriptible autorité du bon
goût". L’appréciation de ce répertoire n’est
plus péjorative, mais elle reste condescendante : les préfaces
parlent de simplicité, de grâce rustique et naïve,
de fraîcheur. Néanmoins, le chant populaire basque
commence à avoir une certaine réputation, à
laquelle le goût affiché du couple impérial
- qui s’offre des récitals de chants basques dans les grottes
de Sare et de Zugarramurdi par un choeur de contrebandiers -,
n’est sans doute pas étranger.
L’étape suivante
est due à l’action d’un compositeur tourangeau qui, lors
d’une audition de chants populaires à Paris en 1885, a
la "révélation " de ce répertoire. Mandaté
par le Ministère de  l’Instruction
publique, Charles Bordes se lance dans la collecte et prononce
une conférence qui fera date à l’occasion du Congrès
de la Tradition basque (tenu à Saint-Jean-de-Luz en 1897)
: c’est La musique populaire des Basques, comprenant 54
mélodies notées. Il y démontre l’intérêt
musical du "chant basque ", en l’analysant pour la première
fois sur la base de critères musicologiques. La parenté
qu’il lui trouve avec le plain-chant et l’aspect rythmique retiennent
son attention : par là, le chant basque s’inscrit maintenant
dans une histoire musicale, et non plus seulement dans une histoire
littéraire, et des passerelles sont établies avec
"la musique artistique ", ce qui permet de comprendre (et donc
d’apprécier) "le vague et la bizarrerie" qui troublaient
tant les George Amé du milieu du siècle. Partout
en Europe, et particulièrement à la Schola Cantorum
de Paris fondée par C. Bordes et V. d’Indy, où plusieurs
compositeurs basques sont formés, on intègre des
chants populaires dans des oeuvres de musique savante à
qui ils sont censés donner une "nationalité musicale".
C’est ce qui se passe également au Pays Basque, en particulier
dans le domaine lyrique. l’Instruction
publique, Charles Bordes se lance dans la collecte et prononce
une conférence qui fera date à l’occasion du Congrès
de la Tradition basque (tenu à Saint-Jean-de-Luz en 1897)
: c’est La musique populaire des Basques, comprenant 54
mélodies notées. Il y démontre l’intérêt
musical du "chant basque ", en l’analysant pour la première
fois sur la base de critères musicologiques. La parenté
qu’il lui trouve avec le plain-chant et l’aspect rythmique retiennent
son attention : par là, le chant basque s’inscrit maintenant
dans une histoire musicale, et non plus seulement dans une histoire
littéraire, et des passerelles sont établies avec
"la musique artistique ", ce qui permet de comprendre (et donc
d’apprécier) "le vague et la bizarrerie" qui troublaient
tant les George Amé du milieu du siècle. Partout
en Europe, et particulièrement à la Schola Cantorum
de Paris fondée par C. Bordes et V. d’Indy, où plusieurs
compositeurs basques sont formés, on intègre des
chants populaires dans des oeuvres de musique savante à
qui ils sont censés donner une "nationalité musicale".
C’est ce qui se passe également au Pays Basque, en particulier
dans le domaine lyrique.
Le premier opéra
se revendiquant comme "opéra basque" est créé
en 1884 à Saint-Sébastien, et fait grand usage de
chants bien connus dans cette ville : sur les annonces, il est
aussi présenté comme ópera de aires vascongados.
Cest le premier d’une série d’oeuvres lyriques s’étalant
sur un demi-siècle, des deux côtés des Pyrénées,
dont nous sont parvenus une vingtaine d’ouvrages, et 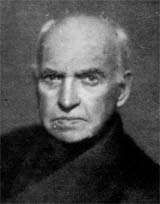 autant
de titres correspondant à des oeuvres disparues, détruites
ou inachevées. En 1909 et 1910 sont créés
plusieurs opéras (Maitena de C. Colin, Mendi-Mendiyan
de J.M. Usandizaga, Mirentxu de J. Guridi) faisant
largement appel aux mélodies populaires, dont le succès
pousse les Députations du Pays Basque méridional
à lancer un concours de chants populaires, afin de recueillir
des "matériaux " utilisables par les compositeurs. Plus
de 2400 mélodies seront publiées en 1922, fruits
des investigations de deux religieux, R.M. de Azkue et le Père
Donostia. autant
de titres correspondant à des oeuvres disparues, détruites
ou inachevées. En 1909 et 1910 sont créés
plusieurs opéras (Maitena de C. Colin, Mendi-Mendiyan
de J.M. Usandizaga, Mirentxu de J. Guridi) faisant
largement appel aux mélodies populaires, dont le succès
pousse les Députations du Pays Basque méridional
à lancer un concours de chants populaires, afin de recueillir
des "matériaux " utilisables par les compositeurs. Plus
de 2400 mélodies seront publiées en 1922, fruits
des investigations de deux religieux, R.M. de Azkue et le Père
Donostia.
A la même époque,
les orphéons (uniquement masculins) se transforment en
chorales mixtes, et beaucoup se tournent vers un répertoire
de chants populaires harmonisés à quatre voix. De
plus en plus de Basques font carrière comme chanteurs lyriques
(et quelques années plus tard, comme chanteurs de charme,
de Luis Mariano à André Dassary) : Madame Bovary,
déjà, faisait intervenir, à l’opéra
de Rouen, un ténor découvert sur la plage de Biarritz
par une princesse polonaise ! Pour le grand public, il apparaît
que les Basques sont bien ce qui se dessine depuis plusieurs décennies
: "un peuple qui chante " - formule qui est d’ailleurs le titre
d’un ouvrage de Jean Ithurriague paru en 1947. Tout le monde sait
maintenant qu’au Pays Basque, on chante : dans la vie quotidienne,
à l’auberge puis au café, à l’église,
dans les pastorales, à l’occasion des bertsu (improvisations
chantées), etc., et le répertoire est considéré
comme un ensemble homogène appelé "chant basque",
d’essence largement rurale. Les nombreux emprunts découverts
dans ce corpus ne changent rien au fait que ce "chant basque",
qui paraît original par rapport aux folklores français
et surtout espagnol, est désormais en charge de l’identité
du pays.
Cette identité
peut être revendiquée sur un plan uniquement culturel
ou avec une dimension politique. Le Gernikako arbola [l’arbre
de Gernika, sous lequel se tenaient les juntes de Biscaye] lui-même,
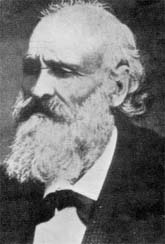 une
chanson écrite en 1853 par J.M. Iparraguirre et rapidement
considérée comme un véritable hymne national
des deux côtés des Pyrénées, peut être
perçue simplement comme une évocation du peuple
basque ou comme une proclamation nationaliste, revendiquant un
type de souveraineté particulier pour le Pays Basque. A
la fin du XIXème siècle et au début du XXème,
les nationalistes se saisissent des chants populaires pour en
faire à la fois un moyen de propagande (profitant de l’impact
émotionnel suscité par les chants du pays, en particulier
quand ils sont interprétés par un choeur considéré
comme sa "voix") et une composante majeure de la "basquitude".
"Le jour où nous cesserons de les chanter, nous aurons
cessés d’être Basques ", écrit en 1918 un
journaliste d’un périodique basque de Buenos Aires. une
chanson écrite en 1853 par J.M. Iparraguirre et rapidement
considérée comme un véritable hymne national
des deux côtés des Pyrénées, peut être
perçue simplement comme une évocation du peuple
basque ou comme une proclamation nationaliste, revendiquant un
type de souveraineté particulier pour le Pays Basque. A
la fin du XIXème siècle et au début du XXème,
les nationalistes se saisissent des chants populaires pour en
faire à la fois un moyen de propagande (profitant de l’impact
émotionnel suscité par les chants du pays, en particulier
quand ils sont interprétés par un choeur considéré
comme sa "voix") et une composante majeure de la "basquitude".
"Le jour où nous cesserons de les chanter, nous aurons
cessés d’être Basques ", écrit en 1918 un
journaliste d’un périodique basque de Buenos Aires.
On mesure le chemin parcouru en un
peu plus d’un siècle, et l’évolution des stéréotypes
associés aux Basques : Vous dansiez ? eh bien, chantez
maintenant ! C’est ce qu’ils font encore en ce début de
troisième millénaire, même si les pratiques
actuelles ne sont plus celles de leurs aïeux.
Natalie Morel
Botrora, Professeur agrégé, département musique
et musicologie, Université Michel de Montaigne Bordeaux III
Photos: Auñamendi |
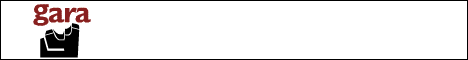

 "A
Pasages, on travaille, on danse et on chante. Quelques uns travaillent,
beaucoup dansent, tous chantent ", écrit Victor Hugo en
1843 à l’occasion de son séjour au Pays Basque.
Le chant est couramment considéré aujourd’hui comme
une spécificité basque, et l’on a limpression qu’il
en est ainsi depuis "toujours". Or, si les Basques ont probablement
"toujours" chanté, on n’a prêté attention
à ce chant que depuis le XIXème siècle ce
qui est finalement assez récent. Auparavant, les Basques
sont réputés pour leurs capacités physiques
(agilité, souplesse, endurance) qui en font des danseurs,
des joueurs de paume, des laquais (utilisés comme coursiers)
et des militaires appréciés. Certes, il se dit que
les Romains avaient remarqué leurs talents vocaux, mais
le "Basque chanteur" ou le "chanteur basque" n’est pas considéré
comme un type représentatif du pays, et les "chants basques"
n’ont pas d’existence en tant que répertoire particulier.
Peu à peu, à partir des années 1800, les
choses se modifient : une notion de "chant basque" apparaît,
très tributaire des mouvements de pensée qui agitent
l’Europe à ce moment-là, et elle devient, au début
du XXème siècle, l’une des composantes majeures
de l’identité basque. Examinons quelques étapes
de ce processus.
"A
Pasages, on travaille, on danse et on chante. Quelques uns travaillent,
beaucoup dansent, tous chantent ", écrit Victor Hugo en
1843 à l’occasion de son séjour au Pays Basque.
Le chant est couramment considéré aujourd’hui comme
une spécificité basque, et l’on a limpression qu’il
en est ainsi depuis "toujours". Or, si les Basques ont probablement
"toujours" chanté, on n’a prêté attention
à ce chant que depuis le XIXème siècle ce
qui est finalement assez récent. Auparavant, les Basques
sont réputés pour leurs capacités physiques
(agilité, souplesse, endurance) qui en font des danseurs,
des joueurs de paume, des laquais (utilisés comme coursiers)
et des militaires appréciés. Certes, il se dit que
les Romains avaient remarqué leurs talents vocaux, mais
le "Basque chanteur" ou le "chanteur basque" n’est pas considéré
comme un type représentatif du pays, et les "chants basques"
n’ont pas d’existence en tant que répertoire particulier.
Peu à peu, à partir des années 1800, les
choses se modifient : une notion de "chant basque" apparaît,
très tributaire des mouvements de pensée qui agitent
l’Europe à ce moment-là, et elle devient, au début
du XXème siècle, l’une des composantes majeures
de l’identité basque. Examinons quelques étapes
de ce processus.
 Sébastien,
un danseur passionné, également historien de sa
province, Juan Ignacio de Iztueta publie un recueil de mélodies
de danses dont une partie sont chantées. Dans sa préface,
il expose l’intérêt que présente à
son avis ce que l’on appellera bientôt le folklore, dans
la perspective d’études historiques comparées, mais
dénie aux chansons qu’il publie toute dimension artistique
: "prétendre [trouver] dans les chants vulgaires les combinaisons
sublimes de l’art serait une erreur grossière", écrit-il.
Cette opinion est assez largement partagée. Georges Amé,
par exemple, le jeune étudiant féru de musique à
qui F. Michel s’est adressé pour une appréciation
"compétente" du livre d’Iztueta, est dérouté
: "dans certains de ces chants, le vague et la bizarrerie sont
tels que j’ai cru avoir devant les yeux de véritables énigmes
", avoue-t-il. Quelques voix ont commencé à s’élever
cependant (en particulier celles d’Anglais qui publient, vers
1840, des récits de voyage agrémentés de
musique notée) pour défendre l’intérêt
musical, et non plus uniquement littéraire, de ce répertoire.
Sébastien,
un danseur passionné, également historien de sa
province, Juan Ignacio de Iztueta publie un recueil de mélodies
de danses dont une partie sont chantées. Dans sa préface,
il expose l’intérêt que présente à
son avis ce que l’on appellera bientôt le folklore, dans
la perspective d’études historiques comparées, mais
dénie aux chansons qu’il publie toute dimension artistique
: "prétendre [trouver] dans les chants vulgaires les combinaisons
sublimes de l’art serait une erreur grossière", écrit-il.
Cette opinion est assez largement partagée. Georges Amé,
par exemple, le jeune étudiant féru de musique à
qui F. Michel s’est adressé pour une appréciation
"compétente" du livre d’Iztueta, est dérouté
: "dans certains de ces chants, le vague et la bizarrerie sont
tels que j’ai cru avoir devant les yeux de véritables énigmes
", avoue-t-il. Quelques voix ont commencé à s’élever
cependant (en particulier celles d’Anglais qui publient, vers
1840, des récits de voyage agrémentés de
musique notée) pour défendre l’intérêt
musical, et non plus uniquement littéraire, de ce répertoire.
 pyrénéens
", profitant du penchant romantique pour la montagne, devenue
un thème littéraire et pictural, et un lieu de villégiature
touristique et thermale. L’année suivante, à Bayonne,
un avocat de Mauléon, J.D.J. Sallaberry, publie ses Chants
populaires basques. A Saint-Sébastien, José
Antonio Santesteban réunira bientôt en recueil les
Aires vascongados qu’il a commencé à faire
paraître isolément à Paris à partir
de 1862.
pyrénéens
", profitant du penchant romantique pour la montagne, devenue
un thème littéraire et pictural, et un lieu de villégiature
touristique et thermale. L’année suivante, à Bayonne,
un avocat de Mauléon, J.D.J. Sallaberry, publie ses Chants
populaires basques. A Saint-Sébastien, José
Antonio Santesteban réunira bientôt en recueil les
Aires vascongados qu’il a commencé à faire
paraître isolément à Paris à partir
de 1862.  l’Instruction
publique, Charles Bordes se lance dans la collecte et prononce
une conférence qui fera date à l’occasion du Congrès
de la Tradition basque (tenu à Saint-Jean-de-Luz en 1897)
: c’est La musique populaire des Basques, comprenant 54
mélodies notées. Il y démontre l’intérêt
musical du "chant basque ", en l’analysant pour la première
fois sur la base de critères musicologiques. La parenté
qu’il lui trouve avec le plain-chant et l’aspect rythmique retiennent
son attention : par là, le chant basque s’inscrit maintenant
dans une histoire musicale, et non plus seulement dans une histoire
littéraire, et des passerelles sont établies avec
"la musique artistique ", ce qui permet de comprendre (et donc
d’apprécier) "le vague et la bizarrerie" qui troublaient
tant les George Amé du milieu du siècle. Partout
en Europe, et particulièrement à la Schola Cantorum
de Paris fondée par C. Bordes et V. d’Indy, où plusieurs
compositeurs basques sont formés, on intègre des
chants populaires dans des oeuvres de musique savante à
qui ils sont censés donner une "nationalité musicale".
C’est ce qui se passe également au Pays Basque, en particulier
dans le domaine lyrique.
l’Instruction
publique, Charles Bordes se lance dans la collecte et prononce
une conférence qui fera date à l’occasion du Congrès
de la Tradition basque (tenu à Saint-Jean-de-Luz en 1897)
: c’est La musique populaire des Basques, comprenant 54
mélodies notées. Il y démontre l’intérêt
musical du "chant basque ", en l’analysant pour la première
fois sur la base de critères musicologiques. La parenté
qu’il lui trouve avec le plain-chant et l’aspect rythmique retiennent
son attention : par là, le chant basque s’inscrit maintenant
dans une histoire musicale, et non plus seulement dans une histoire
littéraire, et des passerelles sont établies avec
"la musique artistique ", ce qui permet de comprendre (et donc
d’apprécier) "le vague et la bizarrerie" qui troublaient
tant les George Amé du milieu du siècle. Partout
en Europe, et particulièrement à la Schola Cantorum
de Paris fondée par C. Bordes et V. d’Indy, où plusieurs
compositeurs basques sont formés, on intègre des
chants populaires dans des oeuvres de musique savante à
qui ils sont censés donner une "nationalité musicale".
C’est ce qui se passe également au Pays Basque, en particulier
dans le domaine lyrique. 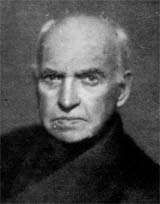 autant
de titres correspondant à des oeuvres disparues, détruites
ou inachevées. En 1909 et 1910 sont créés
plusieurs opéras (Maitena de C. Colin, Mendi-Mendiyan
de J.M. Usandizaga, Mirentxu de J. Guridi) faisant
largement appel aux mélodies populaires, dont le succès
pousse les Députations du Pays Basque méridional
à lancer un concours de chants populaires, afin de recueillir
des "matériaux " utilisables par les compositeurs. Plus
de 2400 mélodies seront publiées en 1922, fruits
des investigations de deux religieux, R.M. de Azkue et le Père
Donostia.
autant
de titres correspondant à des oeuvres disparues, détruites
ou inachevées. En 1909 et 1910 sont créés
plusieurs opéras (Maitena de C. Colin, Mendi-Mendiyan
de J.M. Usandizaga, Mirentxu de J. Guridi) faisant
largement appel aux mélodies populaires, dont le succès
pousse les Députations du Pays Basque méridional
à lancer un concours de chants populaires, afin de recueillir
des "matériaux " utilisables par les compositeurs. Plus
de 2400 mélodies seront publiées en 1922, fruits
des investigations de deux religieux, R.M. de Azkue et le Père
Donostia. 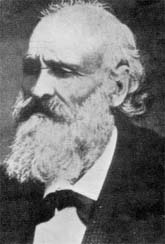 une
chanson écrite en 1853 par J.M. Iparraguirre et rapidement
considérée comme un véritable hymne national
des deux côtés des Pyrénées, peut être
perçue simplement comme une évocation du peuple
basque ou comme une proclamation nationaliste, revendiquant un
type de souveraineté particulier pour le Pays Basque. A
la fin du XIXème siècle et au début du XXème,
les nationalistes se saisissent des chants populaires pour en
faire à la fois un moyen de propagande (profitant de l’impact
émotionnel suscité par les chants du pays, en particulier
quand ils sont interprétés par un choeur considéré
comme sa "voix") et une composante majeure de la "basquitude".
"Le jour où nous cesserons de les chanter, nous aurons
cessés d’être Basques ", écrit en 1918 un
journaliste d’un périodique basque de Buenos Aires.
une
chanson écrite en 1853 par J.M. Iparraguirre et rapidement
considérée comme un véritable hymne national
des deux côtés des Pyrénées, peut être
perçue simplement comme une évocation du peuple
basque ou comme une proclamation nationaliste, revendiquant un
type de souveraineté particulier pour le Pays Basque. A
la fin du XIXème siècle et au début du XXème,
les nationalistes se saisissent des chants populaires pour en
faire à la fois un moyen de propagande (profitant de l’impact
émotionnel suscité par les chants du pays, en particulier
quand ils sont interprétés par un choeur considéré
comme sa "voix") et une composante majeure de la "basquitude".
"Le jour où nous cesserons de les chanter, nous aurons
cessés d’être Basques ", écrit en 1918 un
journaliste d’un périodique basque de Buenos Aires.