|
INTRODUCTION :
L’abus
d’alcool et de tabac chez les adolescentes et les jeunes femmes,
conjointement à la précocité de leurs relations
sexuelles, font que ses répercussions sur les grossesses,
connues depuis deux décennies soient aujourd’hui plus importantes
que par le passé. Bien que les effets de ces drogues légales,
nocives pour la santé soient connus par la population,
leurs effets sur le fœtus sont moins connus ou s’oublient facilement.
L’exposition aux drogues légales (alcool, tabac), ou illégales
(cocaïne, narcotiques, opiacés) est une des principales
causes de troubles du développement des nourrissons pour
des raisons d’environnement. L’objectif de cet article est de
résumer le retentissement fœtal du tabac et de l’alcool,
car plus seront connus leurs effets dommageables sur le nouveau-né,
plus la population sera sensibilisée pour prévenir
ses effets.
L’alcool est beaucoup
plus dangereux pour le nouveau-né que le tabac, c’est la
raison pour laquelle nous insisterons davantage sur ses effets
nocifs, en ne faisant qu’un bref rappel sur les effets du tabac,
avant de conclure par un commentaire général.

EFFETS DE L’ALCOOL
SUR LE NOUVEAU-NE :
1. Effets somatiques
En 1967, Lemoine
et collaborateurs ont décrit les anomalies observées
chez les enfants de mères alcooliques ; plus tard en
1973, Jones, Smith et leurs collaborateurs les ont appelées
"syndrome d’alcoolisme fœtal" (S.A.F.). Les principaux
éléments du tableau clinique observé chez
les enfants atteints de S.A.F. sont les suivants : 50 à
80 % ont un retard de croissance intra-utérin, une microcéphalie,
une dysmorphie faciale avec anomalies des paupières,
un petit nez, une lèvre supérieure marquée,
une hypoplasie mandibulaire. D’autres anomalies malformatives
ont été décrites, notamment des cardiopathies
congénitales ou des anomalies des extrémités.
2. Effets sur le cerveau
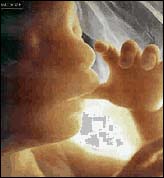 L’effet
de l’alcool sur le cerveau fœtal en développement est beaucoup
plus nocif que son effet sur un cerveau d’adulte. En perturbant
l’organogénèse cérébrale durant toute
la vie embryonnaire et fœtale, des anomalies malformatives se
produisent qui vont empêcher que les fonctions cérébrales
suivent le programme génétique normal prévu.
Ainsi, on observe un retard mental dans 80 à 90 % des enfants
associé à l’existence de malformations diverses
et notamment une atrophie cérébrale et des anomalies
corticales. D’autres anomalies L’effet
de l’alcool sur le cerveau fœtal en développement est beaucoup
plus nocif que son effet sur un cerveau d’adulte. En perturbant
l’organogénèse cérébrale durant toute
la vie embryonnaire et fœtale, des anomalies malformatives se
produisent qui vont empêcher que les fonctions cérébrales
suivent le programme génétique normal prévu.
Ainsi, on observe un retard mental dans 80 à 90 % des enfants
associé à l’existence de malformations diverses
et notamment une atrophie cérébrale et des anomalies
corticales. D’autres anomalies
cliniques pouvant
apparaître comme des troubles du comportement à
type d’irritabilité, d’hyper-activité chez l’enfant,
et des problèmes psycho-sociaux chez l’adulte. Des études
expérimentales chez les rates ont montré que celles
qui ont subi une imprégnation alcoolique durant la période
fœtale présentaient des troubles du comportement par
rapport aux rates témoins n’ayant pas subi cette imprégnation
alcoolique.
3. Quantité d’alcool nécessaire
pour produire les anomalies
Les effets tératogènes
de l’alcool montrent une relation étroite avec le moment
de l’ingestion et le volume de cette ingestion. L’exposition alcoolique
durant le premier trimestre entraîne des anomalies malformatives,
notamment faciales, cérébrales, alors que durant
le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse,
le retentissement sera marqué sur la croissance générale,
la croissance cérébrale et les anomalies neuro-comportementales.
Bien que les anomalies congénitales entraînées
par l’alcool sont proportionnelles à l’intensité
de la consommation, il n’existe pas de volume sous lequel on peut
garantir l’absence de retentissement fœtal. Ce volume peut être
différent d’une femme à une autre. On considère
qu’avec l’ingestion quotidienne de 90 ml d’Ethanol, 40 % des fœtus
présenteront une S.A.F., entre 60 et 90 ml à 20 %,
et entre 30 et 60 ml à 10 %. Pour obtenir une relation entre
les millilitres d’Ethanol avec les boissons habituellement consommées,
il faut savoir que 23 ml d’Ethanol équivalent à
360 ml de bière, 100 à 150 ml de vin, et à
45 ml de liqueur.
EFFETS DU TABAC SUR LE NOUVEAU-NE
:
L’effet du tabac
sur le fœtus est sous-estimé au moins par l’opinion publique.
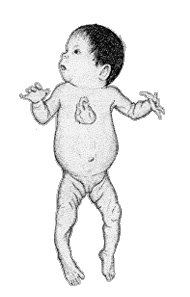 Selon
diverses enquêtes, la majorité des femmes qui fument
ont des difficultés pour sevrer leur consommation de tabac
pendant la grossesse et rares sont celles qui y parviennent. L’incidence
du tabagisme sur la grossesse est très élevée.
Selon des chiffres des Etats-Unis, 30 % des enfants naissent de
femmes tabagiques, et pendant la période néo-natale,
la moitié des enfants sont exposés à leur
domicile à la fumée du tabac. La nicotine et d’autres
éléments inhalés dans la fumée du
tabac ont des effects nocifs sur le fœtus en développement,
en particulier sur la croissance globale, avec de plus la survenue
de façon plus fréquente de complications péri-natales
chez les mères tabagiques : avortement spontané,
hématome rétro-placentaire, placenta praevia, retard
de croissance intra-utérin (les nouveau-nés de mères
tabagiques pèsent en moyenne 200 g de moins). Selon
diverses enquêtes, la majorité des femmes qui fument
ont des difficultés pour sevrer leur consommation de tabac
pendant la grossesse et rares sont celles qui y parviennent. L’incidence
du tabagisme sur la grossesse est très élevée.
Selon des chiffres des Etats-Unis, 30 % des enfants naissent de
femmes tabagiques, et pendant la période néo-natale,
la moitié des enfants sont exposés à leur
domicile à la fumée du tabac. La nicotine et d’autres
éléments inhalés dans la fumée du
tabac ont des effects nocifs sur le fœtus en développement,
en particulier sur la croissance globale, avec de plus la survenue
de façon plus fréquente de complications péri-natales
chez les mères tabagiques : avortement spontané,
hématome rétro-placentaire, placenta praevia, retard
de croissance intra-utérin (les nouveau-nés de mères
tabagiques pèsent en moyenne 200 g de moins).
Le tabac n’affecte
pas seulement la croissance générale de l’organisme,
il retentit également négativement sur la croissance
du cerveau. A ce niveau, une altération dans les mécanismes
de neuro-transmissions a été observée, bien
que les recherches sur les aspects pathologiques ne font que commencer.
Nous connaîtrons mieux dans un futur proche les effets de
la nicotine sur la structure cérébrale et son fonctionnement.
Par ailleurs, il
a été démontré que le tabagisme s’accompagne
d’une fréquence anormale du syndrome de la mort subite
du nourrisson (mort inexpliquée d’enfants entre un et six
mois de vie, sans cause évidente). L’augmentation de cette
fréquence est due aussi bien à l’imprégnation
tabagique pendant la grossesse qu’au tabagisme passif du nourrisson.
Le Professeur Gilbert Barness, dans une série de recommandations
pour prévenir la mort subite du nourrisson, donne comme
un des conseils : l’abstention de fumer pendant la grossesse,
l’interdiction formelle de fumer dans la maison où vit
un nouveau-né.

|
RESUME :
L’alcool est
la cause environnementale évitable la plus importante
de retard mental chez l’enfant, et le tabac est la cause
évitable la plus importante de grossesse pathologique.
Les femmes qui décident d’avoir un enfant doivent
savoir qu’elles doivent éviter de consommer des boissons
alcoolisées en raison du risque de retard mental
et de malformations congénitales. Bien que le retentissement
du tabac soit moins grave que celui de l’alcool, le retentissement
sur la croissance et les risques post-nataux, notamment
sur la mort subite doivent être connus.
C’est un devoir
des responsables de la Santé Publique que de mettre
en place les programmes nécessaires à la prévention
de ces retards mentaux, avec des campagnes publicitaires
et une information correcte de la population en général
et plus particulièrement des jeunes femmes en âge
d’avoir des enfants. |
BIBLIOGRAPHIE :
- Bell GL, Lau K. Problemas perinatales
y neonatales por abuso de sustancias. Clin Pediatr Nort America
1995, 2:247-266.
- Byrd RS, Howard CR. Children´s
passive and prenatal exposure to cigarrette smoke. Pediatr Annals
1995: 24(12): 644-645
- Cruz M, Bosch J. Síndromes
Pediatricos. Barcelona, Espaxs Publicaciones Médicas1998,
534-535
- Eyler FD, Behnke M. Desarrollo
temprano en lactantes con exposición a drogas. Clin Perinatol
1999; 1: 105-149
- Gilbert-Barness E, Barness LA.
Causa de muerte súbita: ¿síndrome o algo más?.
Contemporary Pediatrics 1992; 2:295
- Jones KL, Smith DW, UllelandCN
y cols. Pattern of malformation in offspring of chronic alcoholic
mothers. The Lancet 1973, 1267-1271.
- Lemoine P, Harrousseau H, Borteyru
JP y cols. Les infants des parents alcoholiques: anomalies observées.
A propos de 127 cas. Arch Fr Pediatr 1967; 25: 830-832.
- Malanga CJ, Kosofsky BE. Mecanismos
de acción de las drogas sobre el cerebro fetal en desarrollo.
Clin Perinatol 1999; 1: 17-36.
- Mitchell EA. Ford RP, Steward
AW. Habito de fumar y síndrome de muerte súbita
del lactante. Pediatrics (ed Esp) 1993;35:266-269.
Dr Xavier HERNANDORENA (Hôpital
de Bayonne) et
Dr Pedro GORROTXATEGI (Centro de Salud de Beraun) |



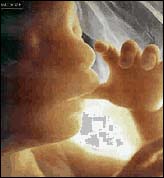 L’effet
de l’alcool sur le cerveau fœtal en développement est beaucoup
plus nocif que son effet sur un cerveau d’adulte. En perturbant
l’organogénèse cérébrale durant toute
la vie embryonnaire et fœtale, des anomalies malformatives se
produisent qui vont empêcher que les fonctions cérébrales
suivent le programme génétique normal prévu.
Ainsi, on observe un retard mental dans 80 à 90 % des enfants
associé à l’existence de malformations diverses
et notamment une atrophie cérébrale et des anomalies
corticales. D’autres anomalies
L’effet
de l’alcool sur le cerveau fœtal en développement est beaucoup
plus nocif que son effet sur un cerveau d’adulte. En perturbant
l’organogénèse cérébrale durant toute
la vie embryonnaire et fœtale, des anomalies malformatives se
produisent qui vont empêcher que les fonctions cérébrales
suivent le programme génétique normal prévu.
Ainsi, on observe un retard mental dans 80 à 90 % des enfants
associé à l’existence de malformations diverses
et notamment une atrophie cérébrale et des anomalies
corticales. D’autres anomalies 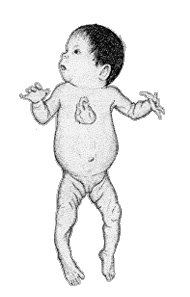 Selon
diverses enquêtes, la majorité des femmes qui fument
ont des difficultés pour sevrer leur consommation de tabac
pendant la grossesse et rares sont celles qui y parviennent. L’incidence
du tabagisme sur la grossesse est très élevée.
Selon des chiffres des Etats-Unis, 30 % des enfants naissent de
femmes tabagiques, et pendant la période néo-natale,
la moitié des enfants sont exposés à leur
domicile à la fumée du tabac. La nicotine et d’autres
éléments inhalés dans la fumée du
tabac ont des effects nocifs sur le fœtus en développement,
en particulier sur la croissance globale, avec de plus la survenue
de façon plus fréquente de complications péri-natales
chez les mères tabagiques : avortement spontané,
hématome rétro-placentaire, placenta praevia, retard
de croissance intra-utérin (les nouveau-nés de mères
tabagiques pèsent en moyenne 200 g de moins).
Selon
diverses enquêtes, la majorité des femmes qui fument
ont des difficultés pour sevrer leur consommation de tabac
pendant la grossesse et rares sont celles qui y parviennent. L’incidence
du tabagisme sur la grossesse est très élevée.
Selon des chiffres des Etats-Unis, 30 % des enfants naissent de
femmes tabagiques, et pendant la période néo-natale,
la moitié des enfants sont exposés à leur
domicile à la fumée du tabac. La nicotine et d’autres
éléments inhalés dans la fumée du
tabac ont des effects nocifs sur le fœtus en développement,
en particulier sur la croissance globale, avec de plus la survenue
de façon plus fréquente de complications péri-natales
chez les mères tabagiques : avortement spontané,
hématome rétro-placentaire, placenta praevia, retard
de croissance intra-utérin (les nouveau-nés de mères
tabagiques pèsent en moyenne 200 g de moins).