|
 Le 16 novembre 1799 mourait Dominique
Garat. Cela fait deux cent ans. Il n'a fait l'objet d'aucune
commémoration ni dans le monde abertzale, ni dans le monde
culturel basque (à part l'Université Basque d'Eté)
ni, à ma connaissance, dans les loges maçonniques,
ou chez les héritiers directs des principes de la République
française. C'est vrai que le personnage est Le 16 novembre 1799 mourait Dominique
Garat. Cela fait deux cent ans. Il n'a fait l'objet d'aucune
commémoration ni dans le monde abertzale, ni dans le monde
culturel basque (à part l'Université Basque d'Eté)
ni, à ma connaissance, dans les loges maçonniques,
ou chez les héritiers directs des principes de la République
française. C'est vrai que le personnage est
difficile à rentrer dans des perspectives réductrices.
En outre, il est
souvent confondu avec son jeune frère Dominique-Joseph.
Il naquît le 12 décembre 1735 à Ustaritz,
siège à notre époque du
Biltzar et du tribunal de bailliage de Labourd. Son père
était médecin, fermier de la dîme, et entretenait
aussi un dépôt de commerce à Arruntz.
Il avait donc suffisamment d'aisance
financière pour pouvoir payer des études à
ses deux fils. Il étudia le droit à Bordeaux et
s'y fit recevoir avocat en 1755, fut même syndic de l'ordre
des avocats. A l'image de nombreux membres de la bourgeoisie,
Dominique fit partie de l'Académie de Bordeaux.
Participant au mouvement des
Lumières, il fit partie de la Loge l'Amitié
établie aux Chartrons à Bordeaux, en fut expulsé.
Il fonda avec quelques autres avocats la Loge l'Harmonie
dont il devint secrétaire. En avril 1789, il fut élu,
avec son jeune frère Dominique-Joseph, député
du tiers état de Labourd aux Etats généraux.
Il ne fut pas un témoin passif des événements
de l'été 1789. Il prit une part active dans la
victoire du Tiers lors des journées de juin 1789, dans
l'élaboration et la mise en place du nouvel appareillage
institutionnel, judiciaire et administratif ; il accéda
au secrétariat de l'Assemblée nationale constituante
le 3 juillet 1790 et assuma cette charge jusqu'au 30 septembre
1791.
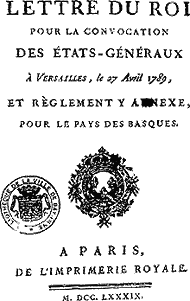 Les
comptes rendus des interventions de Dominique Garat ont été
rapportés aussi bien par Le Moniteur Universel
que par le Journal des assemblées. On peut ainsi répertorier
une quarantaine d'interventions de Dominique Garat entre le 4
août 1789 et le 20 août 1791. Elles ont trait à
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, au
nouveau découpage départemental (par quatre fois,
il réclame un département propre au Pays Basque),
à l'organisation judiciaire, à la suppression des
privilèges seigneuriaux, comme des ordres religieux, à
la constitution civile du clergé, à la peine de
mort (il demande que le parricide aye la main coupée),
aux conditions de détention carcérale, au système
censitaire qu'il refuse au nom de la démocratie. Les
comptes rendus des interventions de Dominique Garat ont été
rapportés aussi bien par Le Moniteur Universel
que par le Journal des assemblées. On peut ainsi répertorier
une quarantaine d'interventions de Dominique Garat entre le 4
août 1789 et le 20 août 1791. Elles ont trait à
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, au
nouveau découpage départemental (par quatre fois,
il réclame un département propre au Pays Basque),
à l'organisation judiciaire, à la suppression des
privilèges seigneuriaux, comme des ordres religieux, à
la constitution civile du clergé, à la peine de
mort (il demande que le parricide aye la main coupée),
aux conditions de détention carcérale, au système
censitaire qu'il refuse au nom de la démocratie.
Il fut arrêté sous
la Convention, emprisonné à Montauban, et
libéré, après la Chute de Robespierre, le
2 septembre 1794. En décembre 1795, Dominique Garat devint
"Président d'administration municipale" dont
l'aire s'étendait, outre Ustaritz, sur Arbonne, Villefranque
et Jaxou. C'est à ce titre que, le 30 ventose an IV (20
mars 1796), Dominique Garat présida le jury qui devait
procéder à la nomination du nouvel instituteur
"le citoyen Pierre Claverie". On vérifia sa
connaissance de la "Dernière Loi constituant de la
République", mais aussi sa maîtrise de la grammaire
basque, car, "dans les communes basques, un instituteur
doit savoir très bien le Basque et le Français,
autrement les écoliers pourroient oublier le
Basque, sans apprendre le français". L'acte, signé
de la main de "Garat Ainé président",
est conservé aux archives d'Ustaritz.
N'appréhendons pas Dominique
Garat avec les paramètres de cette fin de XXe siècle.
Il est de son époque, celle du siècle des Lumières,
à la recherche du "bonheur" des peuples. Et
pour le législateur, il existe une société
idéale, considérée, de manière bucolique,
comme un modèle, c'est le Pays Basque. Car les Basques
sont restés, pensait-on, à l'état naturel,
sans être corrompus à travers l'histoire. C'est
du Jean-Jacques Rousseau, grand bascophile.
Dominique Garat, comme ses contemporains
du siècle des Lumières, est ennemi des structures
de l'Ancien Régime qui a pour nom, à ses yeux,
despotisme et absolutisme. Les nouvelles relations sociales et
politiques qu'il veut bâtir sont édifiées
sur le concept de la citoyenneté, de la liberté
et des droits de l'homme. Mais, dans ce nouvel espace institutionnel
et juridique qu'il veut promouvoir, Dominique Garat pose, de
manière claire, deux exigences qui relèvent du
droit des peuples. La première exigence a trait à
la territorialité du Pays Basque. Lors du découpage
départemental il réclame une entité administrative
qui recouvre les trois "provinces basques", Soule,
Basse-Navarre et Labourd. La
deuxième exigence a trait aux droits linguistiques du
Pays Basque: il exige que les instituteurs soient apte à
assurer l'enseignement de la grammaire basque. Il exige aussi
la traduction en basque des nouvelles lois de la République.
Dominique Garat est ainsi à
la croisée d'un double héritage, celui
de la révolution française dans la mesure où
elle est conçue en termes de valeurs (universelles) républicaines
et citoyennes, de justice au service du bonheur des peuples,
celui de l'identité du Pays Basque.
Manex Goyhenetche, historien |

