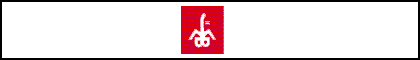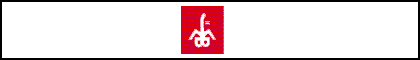|
Texte publié à la revue ONDARE, nº17,
pages 221 - 230, l'année 1998 par Eusko Ikaskuntza - Société
d'Études Basques
Résumé
Le XVIème s. est une
époque difficile pour les provinces basques du Nord des
Pyrénées: invasions espagnoles et guerres de religion
entraînent ravages et incendies. Le courant humaniste,
littéraire et artistique de la Renaissance italienne n'atteint
guère la société locale. La plupart des
familles nobles, de modeste richesse, se contentent de réparer,
au mieux d'agrandir leur manoir ancien. Le seul édifice
où un vaste programme Renaissance a été
mis en oeuvre est malheureusement en ruines: c'est le château
de Bidache.
Laburpena
XVI. mendea garai txarra da
Iparraldeko euskal probintzientzat: inbasio eta erlijio gerrek
suntsipen eta suteak eragiten dituzte. Italiako Berpizkundeko
korronte humanista literaturzale eta artistikoa ez da bertako
gizartera iristen. Aitonen semeen familia gehienek, aberastasunez
urri, nahikoa izango dute beren oinetxea konpontzeko, edota,
gehienez ere, zabaltzeko lanak egitea. Berpizkundeko programa
zabala abiarazi zuen eraikuntza bakarra, zoritxarrez hondatua
gaur egun, Bidaxuneko gaztelua da.
Resumen
El siglo XVI es una época
difícil para las provincias vascas del Norte del Pirineo:
invasiones españolas y guerras de religión que
conllevan destrozos e incendios. La corriente humanista, literaria
y artística del Renacimiento italiano no alcanza a la
sociedad local. La mayoría de las familias nobles, de
modesta riqueza, se conformarán con arreglar, a lo más,
agrandar, su antigua casa solariega. El único edificio
donde un ámplio programa renacentista ha sido puesto en
marcha está, por desgracia, en ruinas; es el castillo
de Bidache.
Parler
de la Renaissance pour les provinces basques de France équivaut
presque à un paradoxe tant le XVIème s. est pauvre
en grands projets architecturaux, pour des raisons que nous allons
étudier, et tant les habitudes médiévales
de construction défensives perdurent. L'impulsion venue
d'Italie s'essouffle avant d'arriver à ces provinces éloignées
des centres vitaux des royaumes de France ou d'Espagne. Peu à
peu cependant, durant le XVIème s., la mainmise royale
française sur le Pays Basque Nord se précise, les
familles nobles, jusqu'alors facilement transpyrénéennes
et de ce fait fort indépendantes et attachées à
leurs traditions, sont obligées de choisir leur camp politique
et leur religion. La fréquentation des fonctionnaires
royaux et des milieux de la cour entraîne ainsi l'adoption
des nouvelles " commodités" dans l'art de bâtir.
Nous allons donc tenter de relever
les traces de cette lente évolution en précisant
tout d'abord le cadre chronologique et politique où s'inscrit
cette étude.
Il est admis, pour la France
comme pour l'Espagne, de faire débuter la Renaissance
dans les années 1490 et de la terminer vers 1600. Pour
l'Espagne, 1492 c'est la reconquête de Grenade et la découverte
de l'Amérique, l'affirmation de la puissance et des ambitions
des rois catholiques qui vont rapidement achever d'unifier la
péninsule avec la conquête de la Navarre sud (en
1512). En France, la guerre de cent ans est terminée depuis
1453. Louis XI est arrivé sans guerre à éloigner
le danger bourguignon. Dans un royaume, peuplé et dynamique,
qui jouit de la paix intérieure, Charles VIII (1483-1498)
et Louis XII (1498-1515) vont pouvoir se livrer aux folles aventures
des guerres d'Italie et ainsi découvrir l'Art de la Renaissance.
Mais pour le Pays Basque Nord,
le XVIème s. est une période confuse et difficile.
Bayonne et le Labourd, repris aux anglais en 1451 grâce
aux efforts de Dunois et Gaston IV de Fox Béarn, vivent
difficilement leur retour dans le royaume de France: perte de
débouchés commerciaux traditionnels, rupture des
liens avec le Guipuzcoa, surveillance active des agents royaux
de Charles VII et Louis XI. Appelé comme médiateur
entre les rois de Castille et d'Aragon en 1463, Louis XI aplanit
les difficultés; il séjourne longuement dans la
région et met habilement à son service plusieurs
familles nobles: Jean de Montréal, seigneur d'Urtubie
le suit vers la Touraine et son absence va durer trente ans.
D'autres familles, les d'Arcangues, les Caupenne d'Amou, les
Garro obtiennent des charges de bailli ou de procureur du roi.
Le Labourd est définitivement sous influence française
comme la Soule reprise aux Anglais en 1449.
Pour la Basse-Navarre la situation
est très complexe: le mariage d'Eléonore de Navarre
avec Gaston IV de Foix Béarn amène le rapprochement
avec la France concrétisé par le mariage de l'héritier
de la Navarre et du Béarn avec la fille de Louis XI.
Mais la mort précoce du
Prince de Viana à Libourne en 1470 entraîne la dislocation
d'un royaume marqué par les séquelles de la guerre
civile. Cédant à la pression des États de
Béarn, l'héritière Catherine de Navarre
choisit l'alliance française en épousant Jean d'Albret
en 1484. Ferdinand d'Aragon attend son heure pour les chasser
de Pampelune en 1512. Le royaume est réduit à la
Navarre d'Ultra Puertos, c'est à dire la Basse Navarre,
la plus petite des possessions territoriales du couple Navarre-Albret.
Pour toutes les familles nobles navarraises depuis les rives
de l'Adour jusqu'à Pampelune, un choix doit se faire désormais
pour leur hommage. S'ils choisissent Catherine et Jean d'Albret
et ensuite leurs descendants Henri II d'Albret-Béarn Navarre,
Jeanne, épouse d'Antoine de Bourbon puis Henri III de
Bourbon-Navarre, c'est la suzeraineté du roi de France
et alors leurs domaines sud sont confisqués; s'ils choisissent
le roi d'Aragon, c'est en fait la suzeraineté de l'Espagne
et ce sont leurs domaines nord qui sont confisqués!
Pauvre royaume "logé
comme un pou" entre la France et l'Espagne qui s'unifient
et qui s'y livrent déjà la guerre: c'est l'expédition
de 1521 d'Henri II d'Albret, vers Pampelune. Mais l'aide trop
mesurée de son royal beau-frère François
I ne lui permet pas de résister à la contre-offensive
de Charles I d'Espagne qui envoie en 1523 l'armée du duc
d'Orange chasser le prétendant, passer les Pyrénées
et mettre à sac aussi bien le Labourd (Saint Jean de Luz
et toute la côte) que la Basse Navarre jusqu'à la
principauté de Bidache au Nord. Il faudra reconstruire
après les ravages des Impériaux.
Il faudra reconstruire aussi
après les guerres de Religion, meurtrières et destructrices.
Jeanne d'Albret choisit le protestantisme et l'impose à
tous ses sujets avec un tel fanatisme que cela entraîne
des rebellions et de dévastatrices expéditions
militaires. A la folie meurtrière du catholique Terride
répond celle du huguenot Montgomery. En outre certaines
familles nobles profitent des troubles pour continuer à
régler de vieux comptes entre elles: ainsi la famille
de Luxe par rapport à ses ennemis héréditaires
les Belzunce et surtout les Gramont.
Ce n'est qu'à la fin de ce terrible XVIème s. que
la Basse Navarre retrouve le calme. Henri III de Béarn
Navarre devient roi de France en 1589. Il ramène la paix
religieuse par l'Edit de Nantes en 1596.
Ce rapide survol historique nous
permet de comprendre pourquoi au XVIème s. tant de châteaux
et de maisons fortes ont été ruinés; les
flammes ont beaucoup ravagé, qu'elles fussent espagnoles,
huguenotes, catholiques. Pour la plupart ils ont été
reconstruits mais avec quels moyens?
La noblesse en Pays Basque Nord
n'est ni très nombreuse, ni très riche: moins d'une
dizaine de maisons nobles en Labourd, une cinquantaine en Soule,
seule la Basse Navarre avec les pays d'Arberoue, de Mixe, et
l'Ostabarret compte 150 maisons nobles. La même famille
possède souvent plusieurs de ces maisons auxquelles sont
attachés plutôt des privilèges honorifiques
que des droits féodaux rentables. Les terres ne sont pas
très vastes, en outre, à partir de 1512 les nombreuses
charges et fiefs de l'ancien royaume de Navarre disparaissent
pour les familles restées "Ultra Puertos". Les
charges données par le roi de France sont les bienvenues
mais il n'y a pas tellement à espérer dans ces
provinces éloignées du centre du pouvoir qui ne
découvrent les fastes royaux et les modes nouvelles que
lors des passages des souverains vers la Bidasoa, lieu privilégié
d'échanges princiers entre France et Espagne.
A la fin du XVIème s.,
l'accession au trône de France d'Henri III le Navarrais,
qui connaît bien ses terres familiales et ses vassaux,
ouvre des opportunités intéressantes. Le roi prend
sous sa protection personnelle nombre de seigneurs locaux (Armendaritz,
Garro, Laxague). Il accepte même de reconnaître à
la plus illustre des familles, celle des Gramont, la qualité
de "princes souverains de la terre de Bidache" avec
des privilèges juridiques et fiscaux (cas unique au Pays
Basque). Diane d'Andoins, duchesse de Gramont, sa maîtresse,
y est pour quelque chose. Il consacre ainsi leur rang dans la
haute et puissance noblesse française. Dotés depuis
longtemps déjà de multiples charges royales, de
bénéfices ecclésiastiques juteux, les Gramont
sont les seuls nobles vraiment riches, même s'ils ont perdu
leurs terres de Navarre.
Fréquentant la cour depuis
Louis XII et François I, voyageant, bataillant en Italie,
ils sont quasiment les seuls à connaître les nouveaux
châteaux royaux, Blois, Chambord, Chenonceaux, à
vouloir et à pouvoir implanter dans tout son éclat,
la Renaissance au sud de l'Adour.
 Bidache, bastion avancé au dessus de la
Bidouze, affluent de l'Adour, est aux mains des Gramont depuis
les premières années du XIIIème s. Originaire
de Villenave, cette famille, s'était illustrée
au service des rois de Navarre auxquels elle rendait l'hommage
pour la terre de Bidache, tout en dépendant aussi des
rois de France pour d'autres possessions. Dualité qui
leur permit de se tourner peu à peu vers le royaume français
au moment où leur puissance navarraise était ébranlée Bidache, bastion avancé au dessus de la
Bidouze, affluent de l'Adour, est aux mains des Gramont depuis
les premières années du XIIIème s. Originaire
de Villenave, cette famille, s'était illustrée
au service des rois de Navarre auxquels elle rendait l'hommage
pour la terre de Bidache, tout en dépendant aussi des
rois de France pour d'autres possessions. Dualité qui
leur permit de se tourner peu à peu vers le royaume français
au moment où leur puissance navarraise était ébranlée
par la guerre civile et les guerres de succession. Les troupes
espagnoles brûlent et ravagent le vieux château féodal
en 1523, lors de leur expédition en Labourd et Basse Navarre.
La famille est éprouvée par les deuils et désastres
de guerre. Mais la jeune veuve, héritière du nom,
et son fils sont protégés par deux oncles fort
influents et fort riches: Claude, abbé de Sorde, archevêque
de Bordeaux, primat d'Aquitaine et Gabriel, cardinal de Gramont,
évêque de Tarbes, plus tard archevêque de
Toulouse et habile ambassadeur auprès de l'empereur Charles
Quint, du roi d'Angleterre et du pape.
Le programme de reconstruction
de Bidache est fastueux. Il démontre que dès le
début du XVIème s. les demeures privées
rivalisent de modernité avec les châteaux royaux.
Ce programme a été
très bien étudié par O. Ribeton dans son
travail minutieux sur le château de Bidache car, dans l'état
actuel, il faut une certaine imagination pour retrouver la totalité
de l'édifice du XVIème s.
A Bidache, le maître d'oeuvre
Gabriel Bourgoing, dont nous connaissons le nom par un document
de 1539 concernant l'achèvement des travaux principaux
du corps de logis et le maître d'ouvrage, Charles de Gramont,
doivent s'accommoder de la présence, même partiellement
ruinée, d'un château féodal, agrandi au XVème
s.
Ils vont donc insérer
les nouvelles constructions dans l'enceinte fortifiée.
Le châtelet d'entrée au Sud, les murailles pourvues
de tourelles et la grosse tour au Nord cernaient un vaste quadrilatère.
Cette surface intérieure est divisée en deux cours
par le corps de logis Renaissance, orienté Est-Ouest,
et par les deux ailes qui s'embranchent sur lui pour rejoindre
les ouvrages défensifs au Nord et au Sud. Cet agencement
de l'espace concilie les deux ambitions architecturales de l'aristocratie
au XVIème s.
 L'allure extérieure du château souligne
un statut social dominant. Dressé sur un éperon
rocheux, il est le symbole visible de l'autorité seigneuriale
et de la puissance militaire. Voici pourquoi les Gramont, pas
plus que d'autres grands féodaux de l'époque, ne
songent à abandonner une expression architecturale qui
avait fait ses preuves depuis des siècles: remparts, tours
rondes, châtelet et pont levis, ouvrages défensifs
adaptés même à la nouvelle artillerie, avec
de larges ébrasements latéraux obliques. Mais depuis
que les seigneurs français ont vu l'Italie, la grandeur
majestueuse des façades largement ouvertes, le luxe des
décors intérieurs, l'agrément des jardins, L'allure extérieure du château souligne
un statut social dominant. Dressé sur un éperon
rocheux, il est le symbole visible de l'autorité seigneuriale
et de la puissance militaire. Voici pourquoi les Gramont, pas
plus que d'autres grands féodaux de l'époque, ne
songent à abandonner une expression architecturale qui
avait fait ses preuves depuis des siècles: remparts, tours
rondes, châtelet et pont levis, ouvrages défensifs
adaptés même à la nouvelle artillerie, avec
de larges ébrasements latéraux obliques. Mais depuis
que les seigneurs français ont vu l'Italie, la grandeur
majestueuse des façades largement ouvertes, le luxe des
décors intérieurs, l'agrément des jardins,
ont fouetté leur amour-propre.. L'architecture domestique
doit s'allier à l'architecture militaire. Comme l'a écrit
A. Chastel, "l'Art de la Renaissance est lié à
la demeure plus qu'à aucune autre époque. Et la
demeure est ici plus que la maison."
Ainsi le périmètre
de l'enceinte délimite intérieurement des espaces
hiérarchisés:
- le portail architecturé qui transforme l'ancien châtelet
(mais celui que nous voyons actuellement a été
refait au début du XVIIIème s.
- la première cour ou cour d'honneur.
-- au fond le corps de logis principal avec une aile en retour
à l'ouest traitée en galerie à arcades.
L'autre aile à l'est, était symbolisée par
un simple mur bas, ouvert sur les jardins, et qui permet à
la lumière de baigner la cour, comme à Villesavin,
la Morinière. La galerie est détruite à
Bidache: était-elle double, ouverte d'arcades au rez de
chaussée, fermée à l'étage comme
à Bury, Fontainebleau, Oiron, Verneuil? On peut le supposer
d'après les arrachements de murs et d'arcades encore subsistants,
d'après la hauteur de la tourelle d'escalier de plan carré
qui s'insère à l'angle galerie/corps de logis.
Cette tourelle contient un escalier à vis en pierre, survivance
médiévale typique. Quant au logis lui-même,
il s'articule sur deux niveaux surmontés de grands combles
coiffés de toits à forte pente et à lucarnes.
Le corps de logis se termine du côté Est par une
façade très soigneusement appareillées.
Il devait être relié à l'angle Nord-Est à
une sorte de tour contenant un escalier en pierre à quartier
tournant. Cette tour donnait-elle accès à une terrasse
ouverte sur le vaste panorama des jardins? Les reprises successives
de travaux fin XVIème, début XVIIème et
les destructions finales, ont rendu le déchiffrement des
ruines de Bidache assez aléatoire.
 Ce qui frappe néanmoins dans ces restes
encore majestueux c'est leur style classique. Le traitement des
façades et des lucarnes est complètement exempt
de toutes les fioritures décoratives, typiques du gothique
flamboyant qui dans la plupart des châteaux de la Loire
témoignent de la difficile adoption de la rigueur italienne
d'Alberti et Bramante (exemples la tour d'escalier de Blois,
la surabondance décorative de Meillant, le couronnement
féerique de Chambord…). Ainsi à Bidache la
lecture traditionnelle de la façade par travées
verticales, culminant aux lucarnes ouvragées, est balancée
par l'importance des éléments horizontaux: de larges
bandeaux plats, en pierres appareillées, soulignent les
divers niveaux. Ces "frises" ne sont pas décorées
d'éléments sculptés. Peut-être avaient-elles
été conçues dans un but d'économie:
le revêtement de pierres bien ajustées leur était
réservé; le reste du mur est enduit sur moellons.
Les encadrements de baies, les allèges, les linteaux,
sont enrichis d'éléments sculptés sobres
et à faible relief, leur traitement reste fidèle
aux modèles toscans (et par là à l'antique):
consoles à volutes, cannelures et acanthe, lucarnes avec
frises à godrons terminées par des acanthes, fronton
triangulaire sans fioritures, triglyphes: les réminiscences
greco-romaines sont nettes. Ce qui frappe néanmoins dans ces restes
encore majestueux c'est leur style classique. Le traitement des
façades et des lucarnes est complètement exempt
de toutes les fioritures décoratives, typiques du gothique
flamboyant qui dans la plupart des châteaux de la Loire
témoignent de la difficile adoption de la rigueur italienne
d'Alberti et Bramante (exemples la tour d'escalier de Blois,
la surabondance décorative de Meillant, le couronnement
féerique de Chambord…). Ainsi à Bidache la
lecture traditionnelle de la façade par travées
verticales, culminant aux lucarnes ouvragées, est balancée
par l'importance des éléments horizontaux: de larges
bandeaux plats, en pierres appareillées, soulignent les
divers niveaux. Ces "frises" ne sont pas décorées
d'éléments sculptés. Peut-être avaient-elles
été conçues dans un but d'économie:
le revêtement de pierres bien ajustées leur était
réservé; le reste du mur est enduit sur moellons.
Les encadrements de baies, les allèges, les linteaux,
sont enrichis d'éléments sculptés sobres
et à faible relief, leur traitement reste fidèle
aux modèles toscans (et par là à l'antique):
consoles à volutes, cannelures et acanthe, lucarnes avec
frises à godrons terminées par des acanthes, fronton
triangulaire sans fioritures, triglyphes: les réminiscences
greco-romaines sont nettes.
Aussi, bien des questions se
posent quant aux influences parvenues jusqu'à Bidache.
Le maître maçon Gabriel Bourgoing, qui était
connu car il travaillait aussi bien à la cathédrale
de Bordeaux qu'aux fortifications de Navarrenx, a-t-il lu Vitruve
ou Alberti? Il a travaillé avec l'ingénieur italien
de Navarrenx (Fabricio Siciliano) mais était-il suffisamment
humaniste pour assimiler l'exemple italien? Ou bien a-t-il fait
travailler des sculpteurs pris sur des chantiers toulousains.
Et dans ce cas cela signifierait que les décors sculptés,
en tout cas les cheminées, sont postérieurs au
document de 1539 et même à la mort de Gabriel Bourgoing
survenue sans doute entre 1548 et 1552.
Reporter jusqu'au milieu du siècle
l'achèvement de cette grande campagne de travaux, démarrée
en 1525, semble plus satisfaisant pour les analogies de style.
Le château, résidence
princière jusqu'à la fin du XVIIème s. a
continué à être embelli, agrandi par les
princes de Bidache successifs: il a connu son heure de gloire
lors de la réception fastueuse de 1659 en l'honneur de
Mazarin. Puis délaissé par les Gramont au XVIIIème
s., transformé en bien national avec hôpital militaire,
il se dégrade de plus en plus jusqu'à 'incendie
final de 1796. Ainsi disparut le seul grand château renaissance
de la région.
Dès la fin du XVIème
s. avait aussi été ruiné le vieux château
féodal de Belzunce (antique et puissante famille du Labourd).
Au service des rois de Navarre jusqu'au XVème s. Ils sont
ensuite dotés de charges importantes par le roi de France.
Mais les guerres de Religion les éprouvent durement: leurs
châteaux de Macaye et surtout d'Ayherre sont brûlés
en 1569. Certes, Ayherre, juché sur un promontoire étroit,
typiquement médiéval par son emplacement et sa
conception de forteresse flanquée de tours circulaires
ne pouvait se prêter aux mêmes transformations que
Bidache. La place est mesurée pour diviser la cour intérieure:
le résultat manque d'ampleur. Le portail d'entrée
n'a pas été transformé pour accueillir les
visiteurs de manière plus pacifique et majestueuse. Les
bouches à feu dans la tour Sud-Est remplacent les anciennes
archères. La seule concession au nouvel art de vivre ce
sont les ouvertures des façades surtout visibles au Nord
avec une grande travée verticale de trois baies superposées
et des encadrements à retour de corniche. Il n'y a plus
de document sur le château; comme il a été
abandonné après avoir été ravagé
dans les années 1567-1569, il est donc très plausible
de dater autour de 1550 ces modifications de façades.
 Toujours en Labourd se trouve le seul château
épiscopal construit vers la fin du XVIème s., entre
1566 et 1578, par l'évêque de Bayonne Jean de Sassiondo.
Le manoir d'Askubea au-dessus d'Ascain est de conception très
simple. Vaste logis sous un toit à double versant traversé
par une tour carrée excentrée en pierres de tailles,
il représente en quelque sorte, avec sa façade
principale en pierres, percée d'ouvertures rectangulaires,
l'extension monumentale de la maison labourdine. A l'origine
il n'y avait que trois pièces par niveau. Mais la simplicité
des volumes n'exclut pas leur équilibre et la pureté
de l'appareil est soulignée par les sobres éléments
de décor telle une très classique niche avec statue
de la Vierge. Les deux porches monumentaux extérieurs,
sommés de boules sculptées, ponctuent une vaste
terrasse: l'un domine l'escalier qui descend vers les jardins
au Nord, l'autre accueille mais il est tout de même percé
d'embrasures de tir. Toujours en Labourd se trouve le seul château
épiscopal construit vers la fin du XVIème s., entre
1566 et 1578, par l'évêque de Bayonne Jean de Sassiondo.
Le manoir d'Askubea au-dessus d'Ascain est de conception très
simple. Vaste logis sous un toit à double versant traversé
par une tour carrée excentrée en pierres de tailles,
il représente en quelque sorte, avec sa façade
principale en pierres, percée d'ouvertures rectangulaires,
l'extension monumentale de la maison labourdine. A l'origine
il n'y avait que trois pièces par niveau. Mais la simplicité
des volumes n'exclut pas leur équilibre et la pureté
de l'appareil est soulignée par les sobres éléments
de décor telle une très classique niche avec statue
de la Vierge. Les deux porches monumentaux extérieurs,
sommés de boules sculptées, ponctuent une vaste
terrasse: l'un domine l'escalier qui descend vers les jardins
au Nord, l'autre accueille mais il est tout de même percé
d'embrasures de tir.
Le château d'Urtubie à
Urrugne présente une architecture complexe, tant elle
s'est modifiée au cours des siècles avec les différents
propriétaires et les nombreuses réparations nécessaires
après les passages mouvementés des armées
espagnoles (entre 1523 et 1636). Pourtant, pour une fois on tient
l'acte de construction d'un château du XVI ème s.:
en 1505, par lettres patentes, Louis XII, roi de France, autorise
son bien aimé écuyer Jean de Montréal à
reconstruire le château d'Urtubie, brûlé en
1497 par Marie d'Urtubie épouse délaissée
durant trente ans par J. de Montréal parti en 1463 pour
suivre Louis XI. A vrai dire Marie s'était assez vite
consolée en épousant un noble de Guipúzcoa,
Rodrigo d'Alzate, et n'acceptait pas de voir revenir son premier
mari après la mort du second.
Jean de Montréal, bien
qu'il connaisse l'Italie, n'a ni l'ambition ni les moyens de
construire un vaste édifice Renaissance. Il veut surtout
un solide ouvrage défensif, d'autant que situé
en contrebas d'Urrugne, le château peut facilement être
à la merci d'un coup de main espagnol dans une zone frontalière.
Le châtelet d'entrée est isolé du corps de
logis. Deux grosses tours rondes encadrent une massive porte
d'entrée mais les adjonctions du XVIIIème s. ont
fait disparaître les bouches à feu et sans doute
le pont levis. Le corps de logis, dont une partie remonte au
XIVème s. (le château n'avait sans doute pas été
détruit complètement par Marie d'Urtubie) présente
de belles traces Renaissance sur sa façade Nord: larges
fenêtres à moulurage très fins, dont les
croisées de meneaux en pierres ont disparu, corniche-cheneau
arrondie dont les naissances d'évacuation sont soigneusement
sculptées. Mais le toit et la charpente ont été
totalement transformés au XVIIème s. ainsi que
les façades Sud et Est.
En Basse Navarre, où il
y avait beaucoup plus de familles nobles, souvent assez modestes,
la tradition médiévale du château fort haut
perché avec de nombreux ouvrages défensifs, n'était
guère représentée. On connaissait surtout
les maisons fortes, blocs rectangulaires cantonnés de
deux ou quatre tours, rondes ou carrées, et parfois ramassées
tout entières en une tour massive comme à Lecumberry
(maison Donamartinea XIVème et XVème s.)
Au XVIème s. ces différentes
familles navarraises qui choisissent de rester sous l'autorité
des Albret-Béarn-Navarre transforment leur demeure mais
sans en altérer l'allure médiévale. A quelle
date? Une seule précision pour Etchauz à Saint
Étienne de Baigorri: la date de 1555 sur l'épigraphe
placée au dessus d'une porte d'entrée, en fait
beaucoup plus tardive, signale sans doute les travaux d'agrandissement
de l'ancienne maison.
 Dans trois maisons fortes, Larrea à Ispoure,
Apatia à Bussunaritz, Etchauz à Baigorri se retrouve
la même typologie: l'ancienne "salle" était
sans doute un rectangle allongé. Au XVème s. il
est doublé jusqu'à devenir un quadrilatère
presque régulier flanqué de tours cylindriques,
mais on retrouve, au moins partiellement à l'intérieur,
un épais mur de refend qui était l'ancien mur extérieur.
L'emplacement de la porte d'entrée, du moins la porte
primitive se trouve ainsi désaxée sur la nouvelle
façade (cf façade Sud de Larrea, N d'Apatia). Parmi
les tours, celle qui contient l'escalier à vis est toujours
la plus ancienne, elle n'est pas loin de la porte d'entrée
d'origine. Les précautions défensives restent encore
très présentes dans ces tours: archères
parfois remplacées par des bouches à feu plus larges.
Fermeture de la porte de l'escalier par une barre de fer comme
à Apatia. Dans trois maisons fortes, Larrea à Ispoure,
Apatia à Bussunaritz, Etchauz à Baigorri se retrouve
la même typologie: l'ancienne "salle" était
sans doute un rectangle allongé. Au XVème s. il
est doublé jusqu'à devenir un quadrilatère
presque régulier flanqué de tours cylindriques,
mais on retrouve, au moins partiellement à l'intérieur,
un épais mur de refend qui était l'ancien mur extérieur.
L'emplacement de la porte d'entrée, du moins la porte
primitive se trouve ainsi désaxée sur la nouvelle
façade (cf façade Sud de Larrea, N d'Apatia). Parmi
les tours, celle qui contient l'escalier à vis est toujours
la plus ancienne, elle n'est pas loin de la porte d'entrée
d'origine. Les précautions défensives restent encore
très présentes dans ces tours: archères
parfois remplacées par des bouches à feu plus larges.
Fermeture de la porte de l'escalier par une barre de fer comme
à Apatia.
Par contre, le nombre de tours
peut varier; il y en a deux seulement à Larrea et à
Etchauz. Les deux échauguettes d'Etchauz, l'une circulaire
et l'autre sur plan carré ont été rajoutées
à des dates postérieures. Seul le château
d'Apatia présente quatre tours d'angle et si l'une est
du XVème s. (avec l'escalier à vis) les autres
sont bien du XVIème s.
 Les agrandissements entraînent de nouvelles
ouvertures traitées en larges baies à croisées
dont les meneaux de pierres ont parfois été supprimés
ou remplacés par des montants en bois. Il reste encore
de beaux ensembles des ces nouveaux fenestrages avec des moulures
soignées, corniches à retour. Le style nouveau
d'ouverture qui laissait enfin entrer la lumière a été
d'ailleurs longtemps apprécié et on ne peut pas
forcément dater du XVIème s. tous les bâtiments
qui en sont pourvus. L'exemple le plus net est le château
de Maytie à Mauléon ou des croisées Renaissance
surplombent des fenêtres déjà d'esprit XVIIème
s., ce qui correspond bien aux dates de construction mais on
peut aussi trouver ce cas en Basse Navarre. Les châteaux
de Macaye et de Méharin où la famille Belzunce
s'est installée après la ruine d'Ayherre, datent
plutôt du XVIIème s. et présentent croisées
à meneaux et tourelles-échauguettes. Les agrandissements entraînent de nouvelles
ouvertures traitées en larges baies à croisées
dont les meneaux de pierres ont parfois été supprimés
ou remplacés par des montants en bois. Il reste encore
de beaux ensembles des ces nouveaux fenestrages avec des moulures
soignées, corniches à retour. Le style nouveau
d'ouverture qui laissait enfin entrer la lumière a été
d'ailleurs longtemps apprécié et on ne peut pas
forcément dater du XVIème s. tous les bâtiments
qui en sont pourvus. L'exemple le plus net est le château
de Maytie à Mauléon ou des croisées Renaissance
surplombent des fenêtres déjà d'esprit XVIIème
s., ce qui correspond bien aux dates de construction mais on
peut aussi trouver ce cas en Basse Navarre. Les châteaux
de Macaye et de Méharin où la famille Belzunce
s'est installée après la ruine d'Ayherre, datent
plutôt du XVIIème s. et présentent croisées
à meneaux et tourelles-échauguettes.
Voici donc un tour d'horizon
des demeures nobles en Pays Basque Nord au XVIème s. Elles
sont certes assez nombreuses mais il est vraiment bien difficile
de se faire une idée des nouveautés architecturales
de la Renaissance à travers elles. Beaucoup d'anciennes
maisons fortes se contentent de quelques transformations qui
se poursuivent d'ailleurs au XVIIème et XVIIIème
s. Le seul édifice qui aurait pu vraiment représenter
la grande période de la Renaissance, Bidache est fortement
dégradé. Il est cependant intéressant de
constater que les influences artistiques à partir du XVIème
s. suivent les changements politiques. Le passage du Labourd,
puis de la Basse Navarre et du Béarn sous influence française
à partir de 1512 entraînent l'arrivée de
maîtres d'oeuvre, maçons, sculpteurs venus de Bordeaux,
Toulouse, Bourges, Tours, qui apportent avec eux dessins, savoir-faire
et techniques, déjà expérimentés
dans d'autres régions du royaume. Il ne faut pas oublier
non plus l'influence toute proche du château de Pau, devenu
résidence royale à partir de 1512. Il n'y a plus
de lien, comme au Moyen Age avec les ateliers du Pays Basque
Sud.
Marie
Claude Berger, docteur en Histoire de l'Art. |